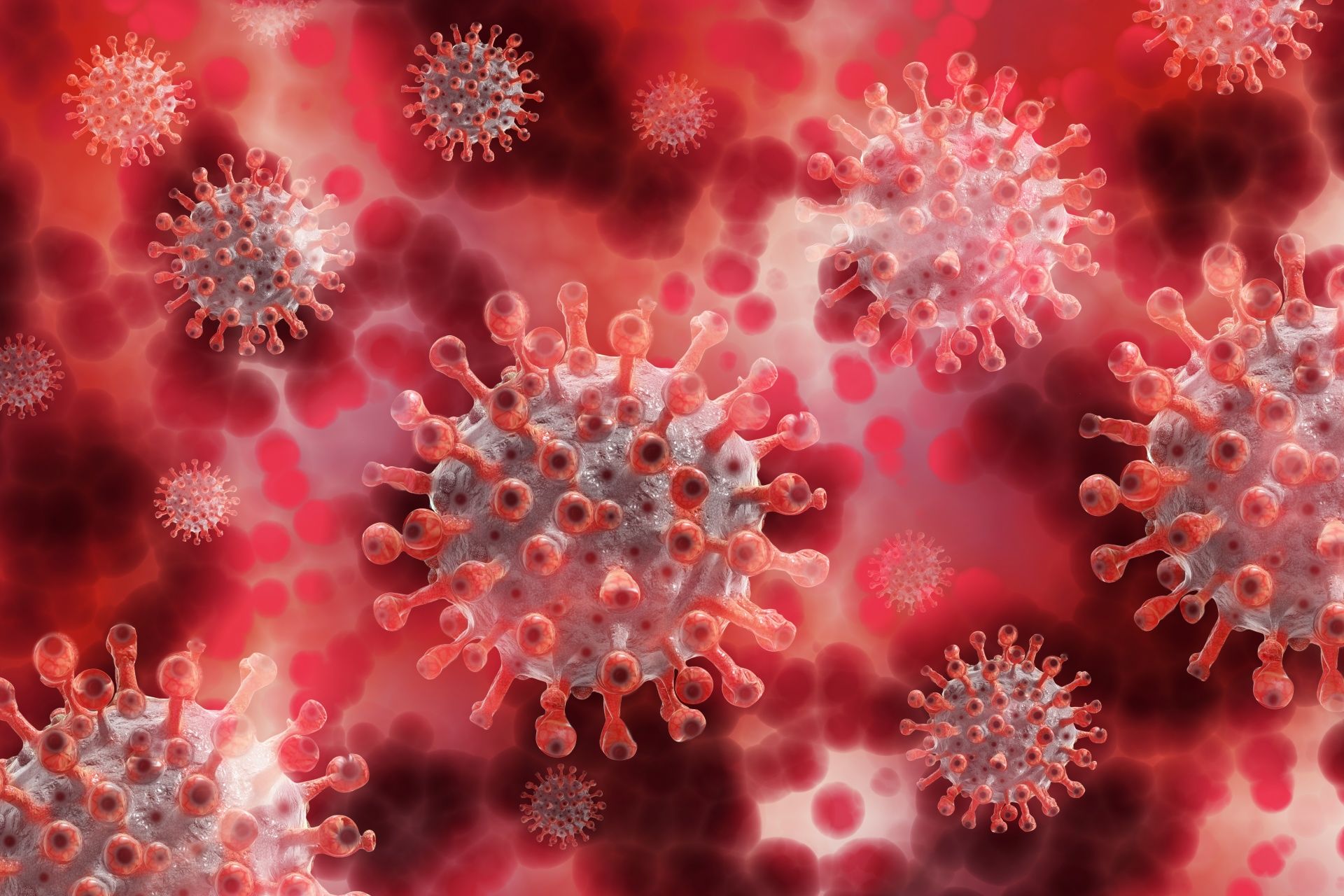
Avec son surnom de roman gothique, le sous-lignage XFG, dit «Frankenstein», refait parler du Covid à l’orée de l’automne. Au Liban, où l’on cumule problèmes sécuritaires, sociaux, frontaliers et transfrontaliers, pénuries, paperasse sans fin, budgets rabotés, instabilité politique, héritage de conflits passés – jusqu’au son et lumière sur la Grotte aux Pigeons – et autres joyeusetés inhérentes à notre beau pays, l’intitulé a tout d’un mauvais teaser. Raison de plus pour s’en tenir aux données – pas aux effets spéciaux – et garder la tête froide.
«Les cas de Covid n’ont jamais vraiment cessé, mais les gens ne se testaient plus: beaucoup s’autodiagnostiquaient “grippe”, sèche ou humide», observe le Pr Jacques Choucair, chef du Service des maladies infectieuses à l’Hôtel-Dieu de France (HDF). Ces dernières semaines, il constate une hausse réelle, portée par les retours de la diaspora et nos habitudes de proximité – «les trois bises, les banquets de famille» – qui favorisent la contagion. Rien de spectaculaire toutefois à l’hôpital: «Une dizaine d’hospitalisations sur la période récente, deux passages transitoires en soins intensifs, aucun décès. On est loin des vagues 2021-2023.»
Le label accrocheur vient d’une hybridation de mutations issues de plusieurs branches du SARS-CoV-2. «Ce n’est pas un terme scientifique inventé par les virologues, mais un surnom popularisé par les médias. L’image de la créature assemblée parle au grand public, mais elle est un tantinet alarmiste», contextualise l’infectiologue.
Hausse maîtrisée, clinique banale
Sur le terrain, il ne voit «pas de virulence particulière» par rapport aux Omicron récents: tableau des voies aériennes supérieures avec mal de gorge inaugural, toux plutôt sèche, fatigue, céphalées et courbatures; fièvre possible; troubles gastro-intestinaux «moins prononcés qu’auparavant». Chez les personnes sans facteur de risque, l’évolution demeure le plus souvent bénigne.
Reste la question du typage: XFG circule-t-il bel et bien chez nous? «Nous n’avons pas, à ce stade, la capacité de séquençage de routine pour l’affirmer», concède le docteur Choucair. Le Liban infère donc sa situation à partir des tendances internationales et régionales. «Au 22 juin 2025, 1 648 séquences XFG avaient été soumises à GISAID, en provenance de 38 pays, soit 22,7% des séquences disponibles cette semaine-là; 65 (4%) venaient de la région Moyen-Orient.» Faute de typage systématique local, l’équipe suit surtout les signaux cliniques et l’occupation hospitalière, ce qui, pour l’heure, ne plaide pas pour un scénario noir.
Gérer en mode endémique: vaccins, tests, traitements
Sur la stratégie vaccinale, le professeur tient une ligne classique et ciblée. «Les personnes à risque doivent être protégées: âgées, obèses, diabétiques, cancéreuses, immunodéprimées, femmes enceintes et insuffisants d’organes», énumère-t-il, en rappelant l’intérêt parallèle de la vaccination antigrippale pour tous. Sauf que la réalité libanaise rattrape vite la doctrine: «Le vaccin Sars-CoV-2 actualisé n’est pas disponible au Liban pour le moment. On fait donc au mieux: conseil personnalisé, priorisation des profils à haut risque dès disponibilité.»
Tester ou ne plus tester? Le professeur Choucair tranche sans dogmatisme. «Un test rapide ou une PCR s’imposent devant un syndrome respiratoire, une fièvre d’origine inconnue, ou à l’admission en milieu hospitalier pour prévenir la contagion et les petites épidémies.» Pas question, en revanche, de dégainer à chaque éternuement: on teste «dès qu’il y a un enjeu de protection d’un proche fragile ou un contexte sensible».
Côté traitements, l’arsenal existe, mais l’accès reste heurté. «Outre le remdesivir IV à l’hôpital, nous disposons du nirmatrelvir/ritonavir, traitement de première intention chez les patients à haut risque, à démarrer le plus précocement possible, idéalement dans les cinq premiers jours de symptômes, pour cinq jours.» Problème récurrent: «Ces deux traitements sont difficilement disponibles au Liban, parfois sur demande.»
Rien ne remplace, dès lors, la prévention à hauteur d’homme. le professeur Choucair insiste sur une responsabilité individuelle et collective: s’isoler quand on est franchement symptomatique, tousser ou éternuer dans sa manche ou un mouchoir, se laver les mains, porter un masque quand on est infecté pendant cinq jours et se faire tester à la moindre suspicion si l’on fréquente des personnes vulnérables. «L’infection est aujourd’hui moins sévère qu’autrefois, mais pour protéger nos aînés et préserver nos services, il faut dépister, isoler brièvement et traiter au besoin», résume-t-il.
Au total, le nom fait plus de bruit que la clinique. XFG, dit «Frankenstein», circule, sans signal de virulence accrue. Le pays n’a pas besoin d’un nouvel alarmisme, mais d’une gestion endémique: protéger d’abord les fragiles, tester quand c’est pertinent, traiter tôt les éligibles et retrouver, sans grand geste héroïque, la discipline des gestes simples.
Le reste n’est qu’habillage de monstre.




Commentaires