
La sexualité n’est pas univoque. Loin des normes figées, la psychanalyse contemporaine accueille les expressions diverses du désir (homosexuelles, bisexuelles, transgenres, asexuelles) comme des récits singuliers, à entendre sans réduire, ni classer, ni corriger.
La psychanalyse ne cherche pas à faire rentrer les désirs dans des cases. Elle ne juge pas, elle n’oriente pas, elle n’impose aucun modèle. Elle écoute. Depuis Freud, elle sait que le désir humain ne suit pas une trajectoire rectiligne, ni même logique. Ce que l’on aime, ce vers quoi l’on tend, ce qui attire ou inquiète, tout cela se construit à travers l’histoire inconsciente du sujet, dans ses identifications précoces, ses errements, ses blessures, ses fantasmes. Le désir est affaire de singularité, non de conformité. Il n’a pas de forme unique. Il peut emprunter mille visages, mille voies, parfois même contradictoires.
Déjà pour Freud, l’homosexualité n’était pas conçue comme une pathologie ni comme un échec ou une perversion. Pour lui, la sexualité est le fruit d’une construction, d’un cheminement psychique. Il voyait dans chaque orientation sexuelle le résultat d’un compromis singulier entre le désir, les identifications, le refoulement, la perte et la défense. Et il reconnaissait que cette orientation pouvait évoluer, toujours selon l’histoire inconsciente du sujet.
La notion de bisexualité psychique, que nous avons citée dans l’article précédent, éclaire puissamment cette pluralité du désir. Chaque être humain, quelle que soit son anatomie, porte en lui une part masculine et une part féminine. Cette configuration interne, que les identifications viennent modeler, autorise une diversité de positionnements dans le désir. On peut être un homme et désirer un homme sans que cela dise tout du sujet. On peut être une femme et aimer des femmes, ou changer plusieurs fois d’objet au cours d’une vie. Le désir n’est pas un destin, c’est une aventure. Et cette aventure ne suit pas de chemins ordonnés.
Les psychanalystes contemporains reconnaissent cette complexité sans chercher à la ramener à des étiquettes. Homosexualité, bisexualité, asexualité, hétérosexualité, pansexualité, autant de tentatives de dire quelque chose de l’orientation du désir, mais sans jamais réussir de façon exhaustive. Ce que la psychanalyse entend, ce n’est pas l’étiquette, mais le récit. Elle ne demande pas «ce que vous êtes», mais «comment cela s’est construit pour vous». L’identité sexuelle n’est pas une définition, c’est un parcours.
L’asexualité, en particulier, a longtemps échappé à une grille explicative. Comment penser une orientation qui ne s’appuie pas sur l’attirance sexuelle? Si la libido est le moteur même de la vie psychique, l’absence de sexualité doit-elle être réduite à une inhibition, un refoulement ou un symptôme? Aujourd’hui, l’asexualité peut être envisagée comme une forme de rapport au monde, une modalité singulière. Ne pas désirer sexuellement ne signifie pas ne pas désirer du tout. Il existe des élans, des liens, des attachements profonds sans qu’il y ait nécessairement passage à l’acte. L’asexualité est aussi une manière particulière d’être existentielle.
La transidentité, elle aussi, a mis au défi les catégories classiques. Si la psychanalyse défend l’idée d’une différence des sexes fondatrice, elle n’adopte pas néanmoins une position rigide. Lacan, en repensant la sexuation comme un processus symbolique plutôt que biologique, a ouvert la voie à une autre lecture. Le genre n’est plus uniquement un reflet du corps, mais une construction langagière, imaginaire et fantasmatique. Ce que dit le sujet de son identité importe plus que ce que montre son anatomie. Ce n’est pas la biologie qui parle, mais le discours. Le choix d’objet n’est pas toujours conforme à ce que la société attend. La psychanalyse ne sert pas la norme sociale, elle sert le sujet.
Les nouvelles figures du genre, (non-binaires, fluidité de genre, agenres) offrent, pour la psychanalyse, une occasion précieuse d’écouter des manières inédites de se situer dans le désir, dans la langue, dans le lien. Il ne s’agit pas de valider ou d’approuver, mais, toujours, de comprendre. Comprendre ce que cela signifie pour tel sujet de se définir ainsi, de vivre ainsi, de désirer ainsi. Il s’agit de saisir les surgissements de l’inconscient du sujet, les figures qui l’habitent, les mots qu’il emploie pour se dire.
Le fantasme occupe ici une place centrale. Car le fantasme, au sens psychanalytique, n’est pas une rêverie ou une image sexuelle. C’est une mise en scène inconsciente qui structure le désir. Il permet au sujet de se situer, de se raconter, de donner forme à ce qui, sinon, resterait informe. Derrière chaque orientation, chaque identité, chaque refus ou affirmation, il y a une histoire fantasmatique. Et c’est cela que l’analyse tente de déplier. Non pour réduire, mais pour faire apparaître ce qui, dans le sujet, cherche à se dire depuis longtemps.
Refuser cette complexité, c’est réduire le sujet à un symptôme ou à une norme. C’est rater la singularité de ce qui s’invente dans la parole. Accepter, au contraire, cette multiplicité des formes de désir, c’est faire confiance à l’inconscient pour tracer ses voies. Ce qui guide la psychanalyse, c’est la vérité subjective du sujet. Même si elle dérange. Même si elle déborde.
La psychanalyse ne dit pas au sujet qui il est, ni qui il doit être. Elle l’aide à donner un sens à ce qui lui échappe, dans ses lapsus, ses rêves, ses répétitions. Et parfois, à lui permettre de dire ce qu’il n’a encore jamais pu dire. Car certains désirs ne trouvent pas de mots dans la langue commune. Il faut alors les inventer, les murmurer, les deviner, les porter jusqu’à la lumière. Et c’est là que le travail analytique prend tout son sens.
La sexualité est l’un des lieux les plus intimes du sujet. Elle est aussi l’un des plus exposés, des plus normés, des plus surveillés. Entre ce que l’on désire vraiment et ce qui est prescrit à désirer, il y a parfois un gouffre. L’analyse n’a pas vocation à combler ce gouffre. Elle s’y tient, elle l’explore, elle y fait résonner une parole. Une parole qui n’est ni militante ni corrective, mais vivante.
Ce que la psychanalyse entend sans juger, ce sont les voix singulières qui disent, dans la douleur ou dans la découverte, comment le désir se cherche, se transforme, se défend, se perd ou se retrouve.

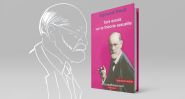



Commentaires