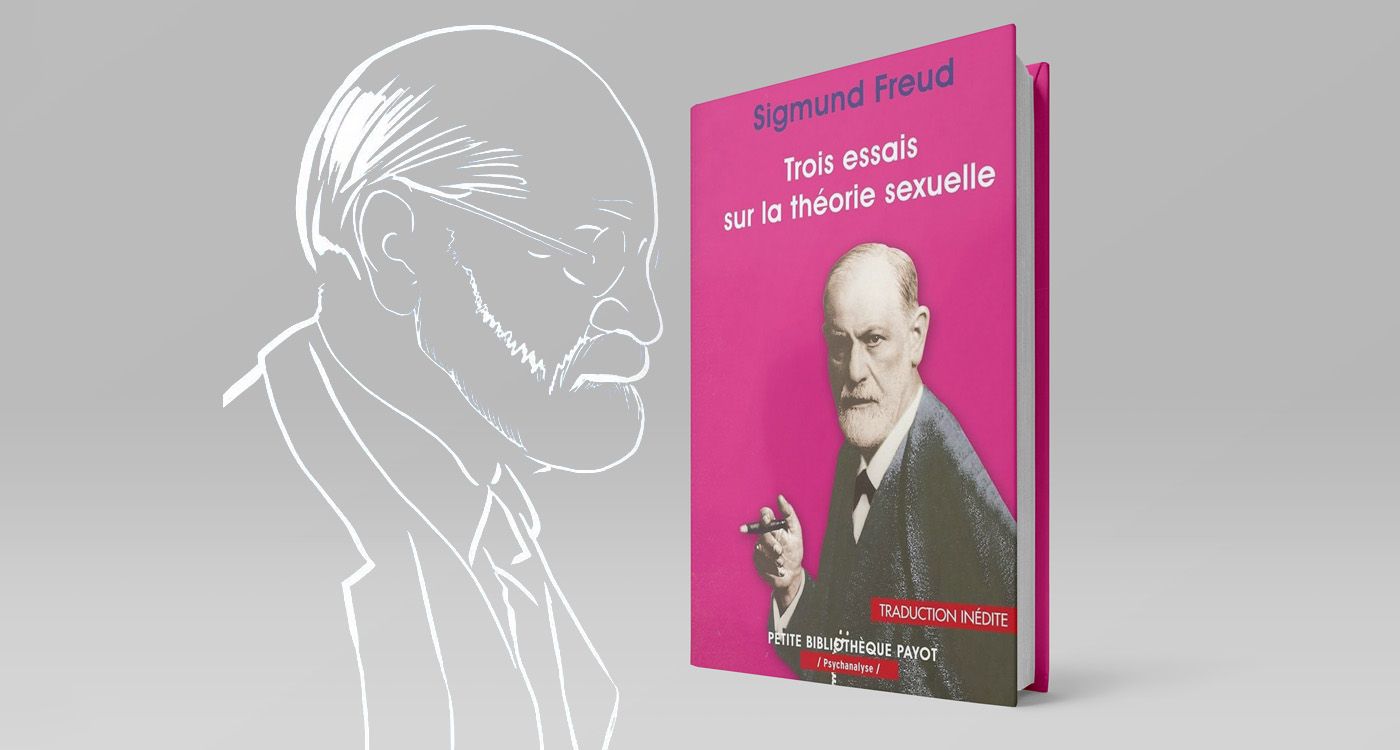
La sexualité ne s’improvise pas; elle s’élabore dès la naissance, à travers le corps, le langage et l’histoire familiale. De la tétée au complexe d’Œdipe, la psychanalyse éclaire les étapes fondatrices du désir et de l’identité sexuelle.
La sexualité humaine est une traversée. Elle ne surgit pas d’un coup au moment de l’adolescence ou du premier rapport sexuel. Elle s’élabore dès la naissance, dans un long tissage de sensations, d’interdits, de fantasmes, d’attachements affectifs et de conflits. C’est dans le corps et dans la psyché infantile que la libido, en tant qu’énergie du désir, commence à prendre forme, à se fixer, à se déplacer. La sexualité humaine est donc aussi psychique et ce que l’on appelle parfois, à tort, «l’instinct sexuel», n’est rien d’autre qu’un processus complexe, conflictuel, toujours singulier.
Dans Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud décrit une succession de phases où la libido investit successivement différentes zones du corps. La première, dite orale, place la bouche au centre de la scène libidinale. Le nourrisson tète, suce, mord, autant de motions chargées d’intensité, où se mêlent plaisir et angoisse. La mère – ou son substitut – devient le tout premier objet d’amour. C’est par elle que le monde se donne à éprouver, dans la satisfaction et la frustration.
Vient ensuite la phase anale, entre un et trois ans, avec ce qu’on appelle l’apprentissage de la propreté. Ici s’articule le rapport à la rétention et à l’expulsion, au contrôle et au lâcher-prise. Les enjeux ne sont pas seulement corporels: l’enfant découvre qu’il peut dire non, qu’il peut retenir ou donner, plaire ou défier. Toute la question du rapport à l’autorité, à l’ordre, au don, commence à se jouer à travers ce que l’on appelle parfois, bien à tort, des «caprices». En réalité, c’est un désir qui poursuit son expression.
Vers trois à six ans, c’est la phase phallique qui se déplie. L’enfant, garçon ou fille, explore ses organes génitaux, les touche, s’interroge. Il découvre la différence des sexes, mais surtout, il s’y confronte de manière fantasmatique. C’est le temps du complexe d’Œdipe que l’on peut décrire rapidement comme le désir fantasmé du garçon pour sa mère, ressentant son père comme un rival, alors que la fille se détourne de sa mère pour orienter son désir vers son père. Les affects sont caractérisés par l’ambivalence des sentiments.
Cette période est décisive. C’est là que se forgent les identifications sexuelles, que s’ébauche une position subjective de genre. L’enfant cherche à ressembler au parent du même sexe, tout en désirant celui de l’autre. Mais ces identifications ne sont jamais simples ni exclusives. Un garçon peut s’identifier fortement à sa mère, une fille à son père. L’inconscient ignore les lignes droites.
À partir de six ans, la période de latence installe un relatif apaisement. Les pulsions sexuelles s’assoupissent sans disparaître. Elles se déplacent vers des activités socialement valorisées (apprentissages, amitiés, activités sportives ou artistiques, etc.). C’est le moment où les désirs œdipiens sont refoulés, où la libido se sublime. Le sujet commence à faire avec la réalité, à la négocier. Mais si cette étape est entravée, si les conflits œdipiens n’ont pas trouvé de sortie symbolique, la vie relationnelle future, avec ses composants affectifs et sexuels, peut s’en trouver compromise.
À l’adolescence, s’ouvre la phase génitale. Le corps change, les pulsions se réactivent. Mais cette sexualité n’est pas un simple aboutissement. Elle est un remaniement: tout ce qui a été vécu dans l’enfance revient sous d’autres formes. Si les désirs réussissent à trouver un objet extérieur, hors du cadre familial, les conflits anciens refont néanmoins surface. Un adolescent entravé, empêché dans ses élans par exemple, rejoue des scénarios infantiles non résolus.
Il faut relever, à ce sujet, un point essentiel: la maturité sexuelle ne dépend jamais uniquement des hormones, mais de la manière dont les étapes psychosexuelles précédentes ont été traversées. Un sujet sexuellement actif n’est pas nécessairement psychiquement disponible à la rencontre, à l’altérité, au désir partagé. Le corps peut précéder la psyché et, parfois, l’affoler.
Freud a introduit une notion essentielle trop souvent oubliée: celle de la précocité de la bisexualité psychique. Chaque être humain, quel que soit son sexe anatomique, porte en lui une part masculine et une part féminine. Ces dimensions sont présentes dès l’enfance, dans les rêves, les jeux, les désirs. Elles ne s’annulent pas mais coexistent, parfois en harmonie, parfois en discorde. Cette bisexualité n’est pas une orientation sexuelle, mais un fait structurel. Le garçon qui admire sa mère, la fille qui rivalise avec son père, dans un jeu du miroir et du double, tout cela participe à la construction d’une sexualité originairement multiple. La culture, la société, les assignations viendront restreindre ou canaliser ce potentiel, mais jamais totalement.
Ce que nous apprend la psychanalyse, c’est que la sexualité est d’abord une affaire de symbolisation. Le corps seul ne parle pas: c’est par le regard de l’autre, par les mots qu’on reçoit, par les attentes qu’on pressent, que le sujet se découvre sexué. Avant même de prononcer un mot, l’enfant est parlé: il est qualifié, nommé, inscrit dans une histoire.
Le sexe biologique est un point de départ. Ce qui comptera progressivement, ce sont les signifiants sexuels qui vont structurer l’identité: être regardé, traité ou désiré comme une fille ou comme un garçon, entendre que l’on est «trop ceci» ou «pas assez cela», par exemple. L’inconscient se forme dans cette trame de mots, de gestes, d’interdits transmis inconsciemment au sujet.
Il n’existe pas deux sujets identiques, ni deux sexualités semblables. Chaque histoire individuelle est subjective, donc singulière. Ce qui a été vécu comme marque d’affection chez l’un a pu être ressenti comme emprise chez l’autre. Le même geste peut être gravé comme amour ou comme rejet. Ce n’est pas le réel qui détermine, mais la façon dont il a été fantasmé, interprété, intégré.
Dans ce tissage complexe, la psychanalyse propose une boussole. Elle ne dit pas ce que doit être la sexualité, mais cherche à comprendre comment elle s’est construite, à partir de quelles blessures, de quels attachements, de quels refoulements.
Le corps sexué est un point de départ, pas une destination. C’est à travers lui, et parfois contre lui, que le sujet invente une façon d’être au monde, d’entrer en lien, d’aimer.
Freud l’avait pressenti: ce que nous appelons sexualité est essentiellement une mémoire du corps, une langue du désir.



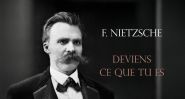
Commentaires