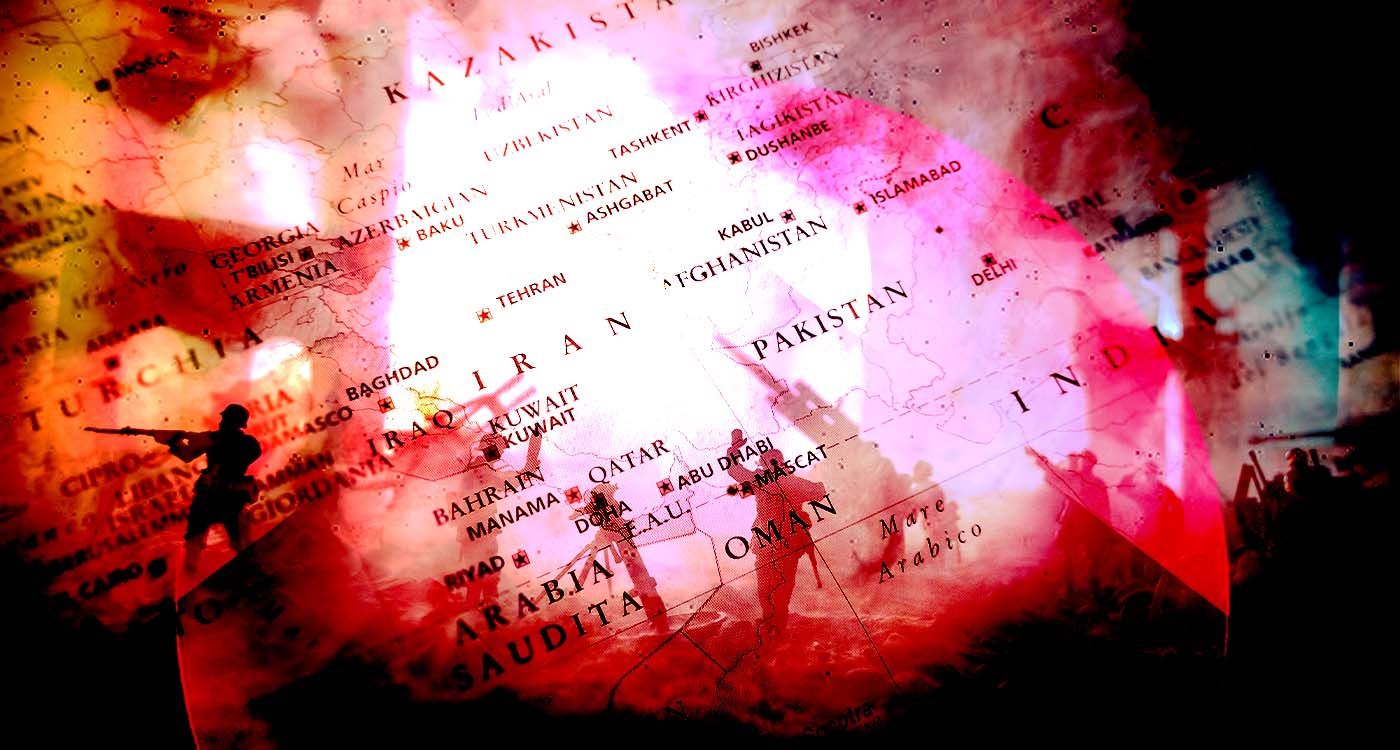
Il est évident que le contexte stratégique moyen-oriental n’est pas facile à naviguer au milieu des contradictions et des incertitudes qui le caractérisent de part en part. Les bouleversements du 7 octobre 2023 et leurs effets en cascade ne sont pas accommodants et rendent malaisées toutes les démarches de paix en l’absence d’un rééquilibrage géostratégique qui mettrait fin aux débridements des conflits en cours.
Les ébranlements majeurs en cours ont remis en cause non seulement les équilibres régionaux déjà fragilisés par les implosions successives du système interétatique, mais également par les dynamiques conflictuelles au sein des États. Nous faisons face à des dynamiques transversales qui s’emparent du système régional et de ses nouages multiples. Il est impossible d’aborder le règlement des questions nationales propres à chacun des États et des pays en proie à des crises cycliques et à des conflits endémiques en l’absence d’une vision d’ensemble qui permettrait d’asseoir les équilibres régionaux sur de nouvelles bases.
La politique iranienne de subversion n’est qu’une des modulations de la politique interventionniste instituée par la binarité conflictuelle de l’Oummah et des États territoriaux qui a succédé à la fin du dernier califat musulman qu’était l’Empire ottoman. Les conflits du système étatique se sont structurés à l’intersection des extraversions politiques et de leurs incidences sur les équilibres internes des États. Il est inconcevable de mettre en action des démarches diplomatiques sur des béances géostratégiques et des dynamiques conflictuelles en cours et d'espérer en venir à bout. L’erreur de la démarche du président français tient à son inconsistance: comment peut-il lancer une dynamique dont les éléments n’existent pas? Il ne suffit pas d’émettre des pétitions de principe dont les effets peuvent être contre-productifs, en l’absence d’une dynamique porteuse.
La tragédie en cours à Gaza ne peut être arrêtée moyennant des projections politiques insuffisamment élaborées et portant sur des enjeux complexes et multidimensionnels. Le conflit israélo-palestinien dans sa dimension propre bute sur des apories multiples qui s’articulent sur les enjeux de la reconnaissance du droit à l’existence de l’État d’Israël et du droit des Palestiniens à un État national. Les guerres successives ont été menées sur la base de la négation du droit de l’État d’Israël à l’existence, et chacune des victoires du Yichouv (l’entité juive antérieure à la fondation de l’État) et de l’État d’Israël se soldait par une défaite du projet national palestinien.
Cela rendait improbable la solution négociée du conflit entre les deux peuples et favorisait l’instrumentalisation de la question palestinienne par les politiques de puissance arabe et islamique et par les internationales de gauche. Le conflit est désormais déréalisé et transmué en conflit emblématique des échecs de la modernité arabo-musulmane et de ses apories multiples. Or il est impossible de dénouer un écheveau conflictuel aux ramifications indéfiniment extensibles.
Le dénouement à ce stade du conflit devrait commencer par l’arrêt des hostilités à Gaza indépendamment du règlement de la question israélo-palestinienne. L’arrêt des hostilités devrait commencer par la cessation des combats, la libération des otages israéliens, le retrait inconditionnel des combattants du Hamas et la mise en place d’un condominium intérimaire cautionné par les autorités israéliennes et l’Autorité nationale palestinienne. Il n’est pas du tout question de concéder quoi que ce soit au Hamas qui cherche à survivre moyennant une double instrumentalisation, celle des otages israéliens et celle de la population civile de Gaza.
Le Hamas et ses commanditaires iranien et qatari portent entièrement la responsabilité du drame humanitaire en cours. Cette déclaration de guerre est criminelle, de part en part, à toutes les étapes de son élaboration et de son exécution. Yahya al-Sinwar l’avait énoncée et en avait fait part à l’officier israélien qui l’accompagnait du temps de la détention: la politique intentionnelle de victimisation quel qu’en soit le coût sur le plan humain, l’instrumentalisation de la population civile comme boucliers humains, et la transformation de l’écologie urbaine en théâtre opérationnel indifférencié où la distinction entre les civils et les combattants est définitivement enrayée. La construction des galeries souterraines (500 km²) a été dûment conçue en vue de miner systématiquement le terrain et d'instrumentaliser les infrastructures éducative, hospitalière, religieuse et sociale à des fins terroristes et au détriment de l’intégrité civile et urbaine. D’où cet épilogue tragique, où la recherche délibérée de la victimisation de la population civile a produit cette hécatombe.
Ce spectacle de désolation n’est pas l’effet du hasard, c’est l’aboutissement d’une politique intentionnelle, inspirée et conçue par les stratégies de subversion des gauches totalitaires dans leurs versions anarchistes et de terrorisme d’État. Il est inconcevable d’établir une équivalence entre la contre-offensive israélienne qui a succédé au pogrom du 7 octobre 2023, en dépit et malgré les dérives qui ont eu lieu dans un contexte où les menaces existentielles, la politique de rétribution et les impératifs de sécurité nationale se conjuguent pour comprendre la trame stratégique israélienne.
Le principe même de la guerre asymétrique rend compte des dérives de la guerre en cours. Les calculs du Hamas étaient parfaitement conscients des aléas de la stratégie criminelle en cours. Il fallait s’abriter derrière les civils pour maximiser les dividendes d’une action militaire, où les atrocités contre les civils israéliens et la victimisation des civils palestiniens servaient de principe de régulation.
La démarche du président Macron est mal avisée dans la mesure où elle va envenimer un environnement qui l’est déjà suffisamment. Il faudrait, d’ores et déjà, dissocier l’urgence d’une solution à la guerre de Gaza et de mettre fin aux drames des deux côtés. Autrement, la solution négociée au conflit vieux de plus de cent ans devrait reprendre tout un legs de résolutions internationales, à commencer par la résolution 182 (1947) qui stipulait la création des deux États, les accords du camp David (1979) et d’Oslo (1993-1995), et poser un nouveau cadre régulateur basé sur les nouvelles dynamiques en cours.
Il faudrait se rendre à l’évidence que les paradigmes des deux États et de l’État unitaire ne sont plus d’aucune pertinence dans le contexte actuel. Il est désormais opportun d’envisager l’hypothèse d’une confédération jordano-palestinienne afin de mettre fin aux impasses d’un conflit basé sur des différends idéologiques, des conflits identitaires et des apories politico-institutionnelles irréconciliables qui alimentent les cycles répétés de violence. La démarche diplomatique de Macron s’avère inopportune et contreproductive si l’on veut une approche séquencée qui mette fin aux drames actuels et au risque de leur reproduction cyclique.
On ne peut pas mettre Israël devant le fait accompli et le mettre en équivalence avec un groupe terroriste et mafieux qui a résolument œuvré à la politique de sabotage qui a enrayé les accords d’Oslo, promu les extrémismes messianiques en milieu israélien et contribué de manière décisive à la marginalisation du camp de la paix en Israël. Ce n’est pas la meilleure politique pour mettre au pas les extrémistes israéliens et favoriser les chances d’un règlement négocié.
Bien au contraire, c’est la démarche la plus indiquée afin de réinstaller les verrouillages idéologiques et de réhabiliter la politique des conflits ouverts. Cette mauvaise inspiration, quelles qu’en soient les motivations, devrait redonner place à la diplomatie classique et à ses schémas de médiation. On ne voit pas comment cette diplomatie du ressentiment va pouvoir briser les cycles de violence et relancer l’échange des diplomaties classiques et alternatives.




Commentaires