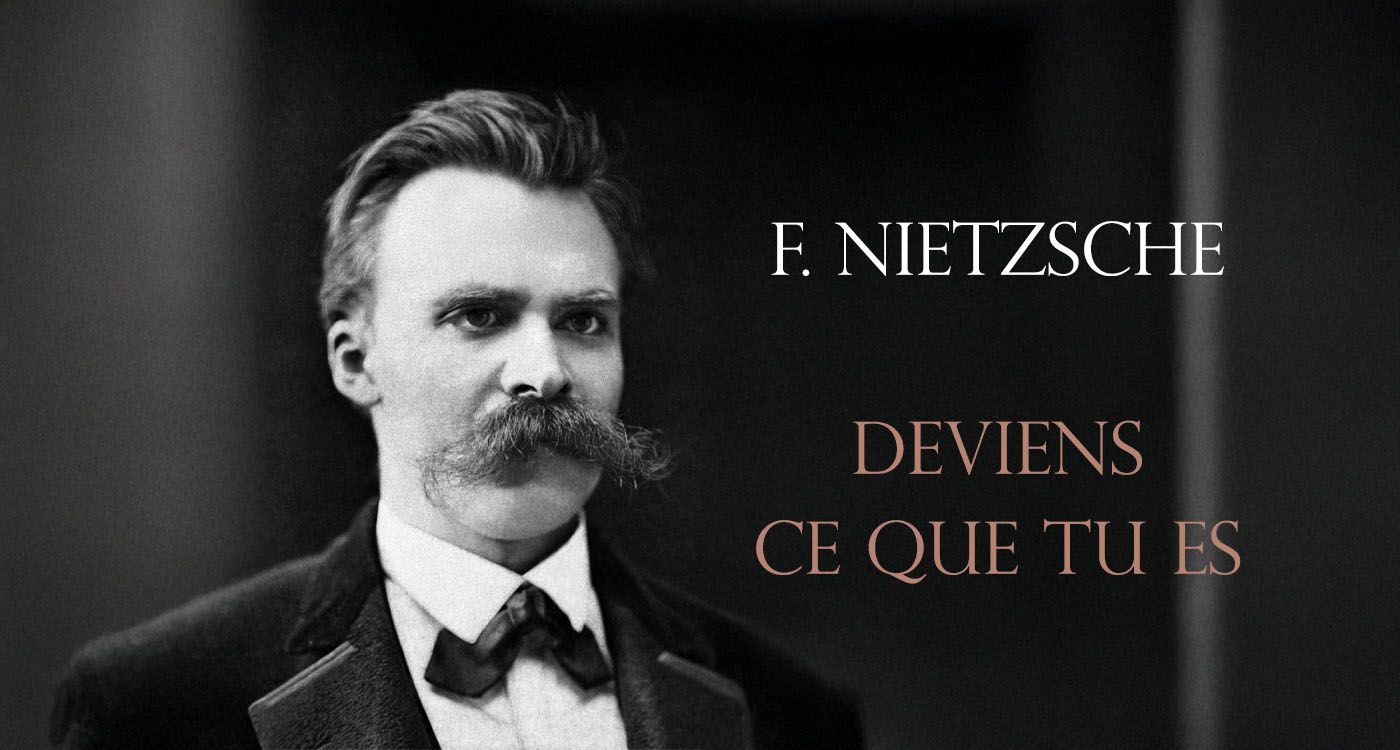
Récupérée par la publicité, l’injonction nietzschéenne «devenir ce que l’on est» retrouve ici sa force subversive. À la lumière de la psychanalyse, l’article interroge le Moi, le désir et la confusion contemporaine entre identité, image et consommation marchande.
Cette recommandation de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, semble, de nos jours, avoir été rangée dans la catégorie de slogan d’annonceur, recyclée par la publicité et l’idéologie positiviste. Il suffit de regarder les injonctions à «être soi-même» qui accompagnent un parfum, un smartphone, une marque de vêtements. Pourtant, si l’on prend au sérieux cette phrase, on découvre un appel qui va exactement à l’encontre de ce théâtre identitaire et rejoint, de façon étonnante, la psychanalyse, lorsqu’elle distingue le Moi de ce que Lacan appellera le «Je», c'est-à-dire le sujet divisé de l’inconscient.
Cette exigence nietzschéenne s’adresse, en réalité, contre l’être humain rassasié, tiède, qui ne veut plus risquer ses certitudes. La morale du troupeau, la recherche du confort, l’idéal d’une vie sans heurts fabriquent des individus interchangeables. Devenir ce que l’on est, c’est rompre avec cette logique de standardisation et consentir à une épreuve, celle de se séparer des valeurs reçues, de supporter l’angoisse de ne plus marcher dans les pas des autres. On n’est pas loin de ce que Lacan formulera, quelques décennies plus tard, en une phrase qui dialogue en sourdine avec Nietzsche: «Là où “ça” était, “je” dois advenir.» Autrement dit, il s’agit de faire advenir un Je éveillé, là où règnent les forces obscures, mais aussi là où le Moi est leurrant. Car le Moi est essentiellement une construction imaginaire, le produit des identifications, des reflets, de l’autre. Le Je, au contraire, désigne le sujet de l’inconscient, ce point de division qui parle sans se confondre avec l’image qu’il donne de lui-même. Le Moi est ce que je crois être, ce que je mets en scène, ce que je raconte à autrui, le Je est ce qui se trahit dans les lapsus, les symptômes, les rêves et les désirs qui me surprennent.
Nous pouvons alors comprendre l’injonction de Nietzsche comme s’opposant à la fortification du Moi ainsi qu’à la consolidation du personnage social, car ce que «tu es», c’est justement ce qui échappe au contrôle, c’est ce qui se manifeste sous forme de désir, de manque. Devenir ce que tu es, au sens psychanalytique, c’est accepter de devenir sujet de cet inconscient, de ne plus se confondre avec ses masques, de ne plus réduire sa vie à la «gestion» d’une image.
Lacan a souvent souligné que le Moi est le lieu des méconnaissances, qui se constitue en poursuivant des images idéalisées, des doubles rivaux, des modèles offerts. Or notre société de consommation a étendu à l’échelle industrielle ce jeu de miroirs. Elle ne se contente pas de vendre des objets, elle vend des identités prêtes à l’emploi. On n’achète plus un vêtement, mais un style de vie, un parfum devient une promesse de singularité. Les campagnes de publicité ne disent pas «achetez ceci», elles suggèrent: «Devenez enfin vous-même» en possédant cet objet. Le sujet est invité à se reconnaître dans des figures toutes faites et chacune de ces figures est adossée à des produits, à des marques, à des objets.
Le malentendu vient de là: l’être se confond avec l’avoir. Je suis ce que je possède, ce que j’exhibe sur les réseaux, ce que je consomme. La structure du désir, telle que la psychanalyse la met en lumière, est alors court-circuitée. Freud comme Lacan insistent sur le fait qu’aucun objet réel, quel qu’il soit, ne peut combler la béance au cœur du sujet. Il y a un manque constitutif, une faille qui ne tient ni à un défaut de l’époque, ni à une malchance personnelle, mais à la façon même dont nous parlons, désirons, nous relions à l’autre. L’économie contemporaine organise ce manque à sa manière, elle le transforme en moteur de consommation. Chaque objet promet une satisfaction qui s’avère toujours décevante, de sorte qu’un autre objet est déjà là, prêt pour prendre le relais.
On comprend alors combien l’injonction nietzschéenne peut devenir profondément subversive. L’enjeu du «devenir» n’est pas le «normal», ni surtout l’«adapté», mais de ne plus céder sur son désir, selon la célèbre formule de Lacan. Refuser de céder sur son désir ne signifie pas tout s’autoriser ni suivre tous ses caprices, mais cesser de rabattre son propre mouvement intime sur les attentes supposées de l’autre, qu’il s’agisse des parents, de la société, ou de l’immense Autre qu’est devenu aujourd’hui le marché.
L’éthique qui se dessine là est aux antipodes de l’injonction contemporaine à «jouir» que Lacan analyse comme la voix moderne du Surmoi. Le Surmoi ne cesse d’enjoindre : travaille, sois performant, amuse-toi, profite, cajole ton corps, dépasse tes limites. Plus on s’efforce d’obéir, plus on se sent coupable de ne jamais en faire assez. La parole de Nietzsche, elle, n’exige pas de performances visibles, ne prescrit pas de résultats. Elle invite à une fidélité à soi qui peut impliquer de décevoir le monde, de renoncer à certaines formes de réussite socialement valorisées, d’habiter sa vulnérabilité plutôt que de la masquer.
La littérature offre une scène exemplaire de cette tension dans le destin d’Emma Bovary. Flaubert met en scène une jeune femme habitée par des images romanesques. Elle a lu des récits de passions exaltées, de bals étincelants, de voyages lointains. Avant même d’avoir vécu quoi que ce soit, Emma sait comment jouer le scénario. Lorsqu’elle épouse Charles, modeste officier de santé, la déception est moins liée à la réalité de cet homme qu’au décalage entre sa vie et l’image de la vie qu’elle a rêvée. Dans un monde rural en mutation, où les marchandises circulent de plus en plus, Emma se met à acheter des étoffes, des meubles, des bijoux, des bibelots. Chaque acquisition lui fait sentir, pendant un moment, que sa vie ressemble à celle des héroïnes admirées.
Emma n’est pas seulement victime d’une grande sentimentalité, elle est prise, comme les figures modernes, dans une logique précoce de consommation identitaire. Elle se prend pour les modèles qu’elle imite, pour les images qu’elle voit, pour les objets qu’elle possède. Son Moi se construit comme vitrine, alignement d’attributs, telles les amours adultères, les toilettes élégantes, le décor bourgeois. Tout se passe comme si elle cherchait à «devenir» en accumulant des signes, sans jamais s’interroger sur ce qu’elle désire, elle, en dehors des scénarios empruntés. Flaubert, en observateur cruel, montre la vacuité de cette quête, car les hommes qu’elle rencontre, Rodolphe ou Léon, jouent, eux aussi, des rôles, s’épuisent dans le mensonge ou la lâcheté. Les objets si patiemment acquis finissent saisis, entassés, se révèlent dérisoires devant l’ampleur de sa détresse.
Aujourd’hui, l’espace où se joue cette confusion a changé de forme, mais non de structure. Les réseaux sociaux sont devenus le grand miroir où chacun ajuste son Moi. On y publie des fragments de vie qui deviennent autant de supports d’identification, de comparaison, de rivalité. On y forge des identités, parfois avec une authentique dimension libératrice, mais aussi sous la pression de catégories qui deviennent à leur tour des étiquettes commerciales, des niches marketing. La psychanalyse, de son côté, met en garde contre la tentation de réduire le sujet à un diagnostic, à une catégorie clinique, à un profil psychologique étroit. Elle rappelle avec obstination que le Je ne se laisse enfermer dans aucune grille. Le patient qui se dit «ADHD» ou «phobique» ou «bipolaire» s’enferme dans sa cage, alors que la cure vise précisément à faire surgir, derrière l’étiquette, une histoire singulière, une manière unique d’avoir composé avec les traumatismes, les rencontres, les pertes.
En la relisant à la lumière de la psychanalyse, on comprend que la véritable modernité de Nietzsche est de postuler un sujet qui ne se réduit ni à l’individu consommateur, ni au citoyen obéissant, ni à l’ego narcissique. Il anticipe l’idée fondamentale que nous ne coïncidons jamais tout à fait avec nous-mêmes, et c’est de cette non-coïncidence que peut naître une vie plus intense. La tâche n’est pas de devenir conforme à une image, mais d’habiter cette distance, de la travailler jusqu’à ce qu’elle prenne la forme d’une voix, d’une œuvre, d’un geste, aussi minime soit-il, qui ne puisse être signé par personne d’autre, qu’ils soient moralistes, politiciens, experts ou publicitaires.




Commentaires