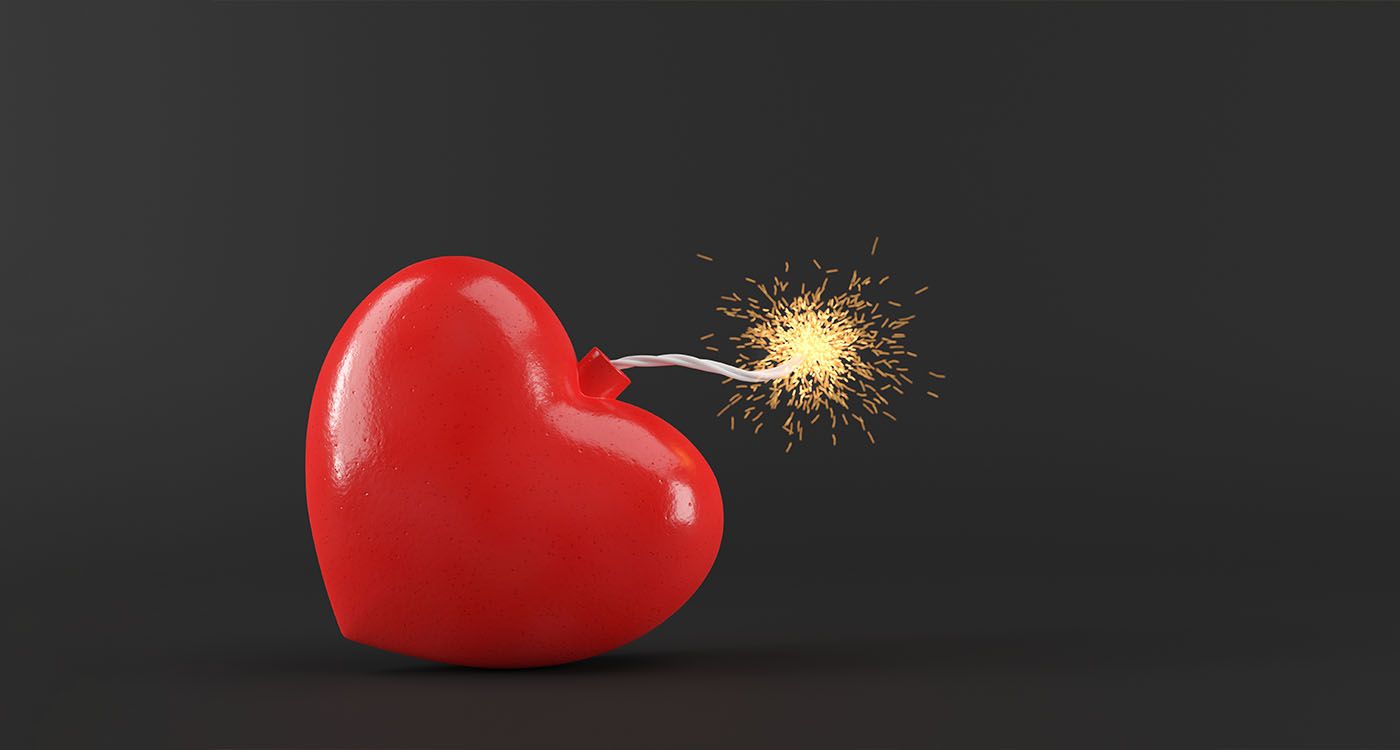
Le love bombing désigne une avalanche d’attentions et de déclarations visant à accélérer artificiellement l’attachement amoureux. Derrière cette générosité ostentatoire se cache souvent une stratégie de contrôle et une intolérance à l’attente et à la frustration.
Le love bombing, dans le langage numérique, mais aussi dans le langage courant, c’est littéralement un bombardement d’amour. Cette expression désigne une phase de séduction où l’autre est submergé d’attentions, de déclarations, de preuves ostensibles d’intérêt (messages torrentiels, cadeaux, projets fulgurants, folles promesses). Ce n’est pas tellement la passion ou l’enthousiasme joyeux d’une rencontre, c’est plutôt un montage d’intensité calculée, une scénographie de l’absolu qui vise, consciemment ou non, à précipiter l’attachement, à accélérer la confiance et à court-circuiter l’attente.
Derrière l’éclat trompeur du love bombing, il y a, en effet, moins un élan amoureux qu’une stratégie de saturation. Tout le monde croit voir de quoi il s’agit, tout le monde a dans l’oreille un «tu es l’amour de ma vie» soufflé trop vite, un «on était faits pour se rencontrer» décrétés avant même qu’une relation s’enclenche. C’est ainsi que se met en place une économie où la dépendance n’est pas un effet secondaire malheureux, mais la finalité implicite du dispositif, celui d’attacher vite, de tenir serré de régir par alternance.
Freud nous a donné l’outil pour lire ce théâtre. Dans le va-et-vient entre amour d’objet et amour de soi, il a montré comment l’idéal du moi cherche dans l’autre l’image de sa propre valeur. Le love bombing apparaît ainsi comme une fonction narcissique destinée à obtenir la confirmation immédiate de soi. Je t’inonde pour que tu m’authentifies, je t’érige en témoin d’un roman où je tiens le premier rôle. L’excès, à cet endroit, sert d’écran contre la castration symbolique. On refuse le manque, on repousse l’attente, on disqualifie la frustration. Plutôt que de consentir à l’intervalle (là où le désir s’éveille), on comble pour maîtriser. Le bénéfice secondaire du symptôme est de se protéger du risque de la rencontre de l’autre qui, ébloui, n’a plus le temps d’éprouver ce à quoi il consent.
Melanie Klein éclaire le clivage qui anime ce processus. L’idéalisation, au début, brille comme le début d’une idylle. L’objet est tout bon, tout réparateur, sauveur. Et celui ou celle qui reçoit tant de «bonté» se sent sommé de (se) rendre, de s’aligner, d’être à la hauteur de l’amour proclamé. Puis la réalité s’impose avec un corps qui fatigue, un désir qui ne coïncide pas, un tempo qui réclame de la lenteur. L’éclat se fissure et l’objet chute, l’idéal se retourne en déception mordante. L’excès initial n’était pas la signature de la maturité, mais l’aveu d’une intolérance au conflit présent dans toute rencontre. Là où la position réaliste accepte que l’autre soit porteur d’affects ambivalents, le love bombing refuse la nuance, idéalisant pour mieux dévaluer, comblant pour mieux punir.
D. Winnicott, de son côté, permet de saisir le travestissement du don. Il savait que donner vraiment, c’est offrir sans exiger, laisser l’autre recevoir à sa manière, au rythme qui est le sien, voire refuser. Or le don du love bombing n’a rien d’un cadeau. Il est prodigué pour prendre, il enveloppe pour contraindre. Le faux-self s’y reconnaît à l’amabilité affichée d’une attention persistante, à une sollicitude de tous les instants, à une générosité ostentatoire. Mais dans ce jeu-là, il n’y a pas d’épaisseur, car l’aire transitionnelle, cet espace où l’illusion se tente pour conduire à la rencontre ou au renoncement, est court-circuitée. À la première demande de recul, apparaît la rancœur («avec tout ce que je fais pour toi…»). Toute cette générosité se révèle être un gage au sens de dette.
J. Lacan, enfin, ramène la scène au nœud de la demande. Demander de l’amour, disait-il, c’est au fond réclamer de l’être («dis-moi que je suis aimable»). Le love bombing parle cette langue en suraigu, il adresse à l’autre une demande infinie, déguisée en offrande. Tout est visible, tout est écrit, tout est promis, et l’objet a, ce petit rien qui cause le désir, fait de retrait, d’opacité, de mystère, est avalé par la scénographie. L’on croit faire naître le désir par l’excès alors qu’en réalité, on l’étouffe. Et lorsque le manque réapparaît (une réponse qui tarde, un week-end sans message), l’autre est accusé de faillir. Car la jouissance n’était pas celle de la rencontre, mais celle de la maîtrise. Le comblement n’était pas un surplus de tendresse, c’était une manière de régner sur le tempo, d’imposer la fiction et d’en contrôler chaque page.
S. Ferenczi, attentif aux malentendus de la tendresse, pointe la confusion des langues au cœur de cette comédie puisque la langue de la douceur («je prends soin de toi», «laisse-toi faire, je m’occupe de tout») est mobilisée au service d’une visée passionnelle et possessive. La personne qui reçoit se croit aimée pour elle-même, mais se découvre engagée dans un pacte auquel elle n’a pas souscrit.
Le langage populaire est éclairant. On dit: «il/elle m’a bombardé(e) d’amour», «c’était trop, trop vite», «je me sentais en sécurité, puis étouffé(e)», «il/elle organise tout, je n’ai plus d’air». Ces formules disent la même chose que la théorie avec une pudeur affûtée, la douceur promise n’étant pas celle qui a du temps devant elle, c’est une douceur de vitrine qui interdit la prise d’haleine. Elles disent aussi la dette insinuée, car le «avec tout ce que je fais pour toi» transforme l’amour en gestion, le geste en registre.
Les plateformes numériques, on le sait bien, amplifient la tentation. L’instantanéité autorise le roman en continu, la logistique rend le cadeau immédiat, l’interface transforme la conversation en métrique. La technique n’invente pas le love bombing, mais elle accélère son cours.
Le love bombing vole le temps qui devrait être celui de la réflexion, de la surprise et du doute. Il fabrique un passé commun fictif qui disqualifie le présent. Alors que l’amour adulte, au contraire, est l’art de la durée, qui autorise le droit de se tromper et laisse la place à l’après-coup et se permet le banal qui dégonfle les fantasmes. Celui qui refuse le moindre ennui refuse la réalité, celui qui supporte la suspension, l’imprécision, gagne la chance d’un clair-obscur habitable.


Commentaires