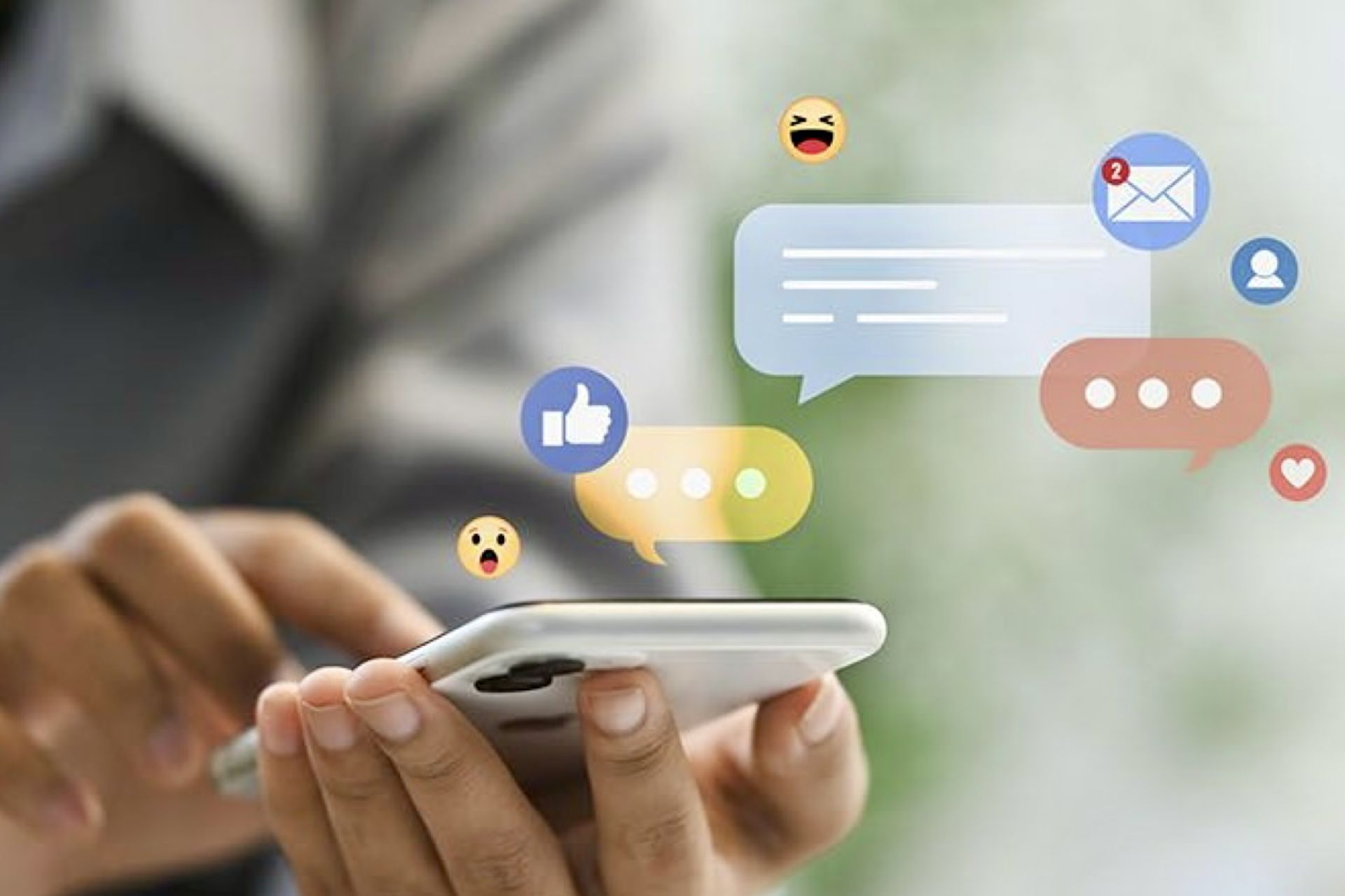
À l’ère des réseaux sociaux, l’orbiting désigne ce phénomène moderne où l’on gravite autour de l’autre sans jamais entrer en contact direct, entre voyeurisme numérique et incapacité à assumer la vulnérabilité d’une véritable rencontre.
Toujours en piochant dans la nouvelle grammaire des interfaces, nous trouvons le néologisme d’orbiting. Il désigne la conduite de quelqu’un qui cesse toute adresse directe (plus de messages directs, pas d’invitation, aucune prise de rendez-vous), mais continue de «tourner autour» de vous. Il regarde vos stories, aime vos publications, suit vos déplacements numériques, parfois commente en public ce qu’il ne souhaite pas soutenir en privé. L’orbiteur renonce au dialogue, mais pas à la mise en scène. Il vous transforme en astre qu’on observe depuis un télescope, dont on goûte le rayonnement, sans supporter la chaleur d’une rencontre.
L’orbiting est une présence oblique qui maintient la visibilité tout en conjurant la vulnérabilité de la parole. C’est une ellipse qui révèle un travail complexe du regard, de l’envie et du narcissisme, qui organise des défenses contre l’angoisse de l’engagement et, plus sourdement, contre l’effraction de l’Autre comme altérité non maîtrisable.
Dans le langage populaire, «il/elle m’orbite» signifie: «il/elle ne répond plus, mais continue de voir tout ce que je publie; il/elle like, apparaît, disparaît, donne des signes de vie périphériques». L’orbiteur visionne vos stories, commente avec des expressions neutres, utilise éventuellement plusieurs comptes pour vous surveiller sans se faire repérer.
S. Freud a déployé, avec la pulsion sexuelle, une série de pulsions partielles dont la pulsion scopique (regarder/être regardé) forme un noyau. Pour l’orbiting, la jouissance se loge dans l’acte d’épier l’autre, d’absorber ses images, de s’installer comme voyeur privilégié d’un quotidien exposé. Il/elle jouit de regarder sans être pris dans la réciprocité, il/elle entretient une excitation contenue, chaque story devient une offrande visuelle que l’on consomme sans rendre la pareille. On retrouve là un bénéfice secondaire narcissique: «Je me confirme comme centre puisque je maîtrise quand et comment je te vois, et je demeure indemne, car le regard ne m’expose pas au risque d’une confrontation à la réalité». Dans cette posture, l’orbiteur répète un scénario plus ancien, lorsqu’il surveillait son environnement pour anticiper la satisfaction ou la blessure, croyant prévenir une déception en la devançant.
L’orbiting exerce une maîtrise sur la temporalité du désir, empêche la parole de forcer l’acte. On pourrait dire que l’orbiteur refuse la castration car tant qu’il ne s’engage pas, il n’a pas à reconnaitre le manque en lui. Il évite le quiproquo, la déception, le malentendu. L’orbiting devient ainsi la technique par excellence de l’anti-rencontre, l’autre est consommé comme image, mais non accueilli comme sujet. Celui-ci est réduit à une peluche numérique qu’on caresse de likes, à un biberon de stories. L’orbiteur évite ainsi l’angoisse de séparation, mais aussi la maturité des liens.
D. Winnicott a théorisé le faux-self, cette organisation défensive qui protège le vrai self, mais peut aussi l’étouffer. L’orbiteur, souvent, offre le visage lisse du faux-self (toilettage des apparitions publiques, sociabilité légère, réactions plaisantes), tout en dissimulant sa profonde crainte de s’exposer, de décevoir, d’être rejeté. Le faux-self orbite impeccablement tandis que le vrai self se tient coagulé, hors parole.
Quant à S. Ferenczi, il a mis à nu la «confusion des langues» entre le langage tendre de l’enfant et le langage passionnel de l’adulte. Transposée au phénomène dont nous parlons, la confusion de l’orbiting tient à ceci que le langage des plateformes (visions, vues, réactions) se présente comme de la présence, mais ne soutient pas la charge d’une adresse véritable. Pour celui/celle qui subit l’orbite, chaque signe peut être lu comme une promesse et se révèle n’être qu’un bruit de fond. Il s’ensuit une série de frustrations (espoir relancé, mais sans aboutissement, parole ajournée, blessure d’être vu sans être choisi).
Chez Lacan, le regard est l’une des formes de l’objet a, ces «petits objets» qui causent le désir tout en restant inassimilables. L’orbiteur, en tant que sujet du regard, se met exactement à l’endroit où il capte l’objet a chez l’autre (sa présence imagée, sa mise en scène), sans jamais offrir, en retour, son propre manque au symbolique. Il demeure dans l’imaginaire, là où l’image circule, où l’autre est pris comme surface, silhouette, fantasme.
Dans l’orbiting, le temps est étiré. Il n’est jamais clôturé, jamais engagé. L’elliptique empêche la temporalité de s’ordonner (début, milieu, fin). Or le désir se nourrit d’un après-coup. Il veut être racontable. Une histoire de vue-anxieuse, de like-pulsé, de commentaire-blanc produit un présent perpétuel. Le sujet, prisonnier de l’instant, n’atteint ni le deuil (s’il faut perdre), ni la rencontre (s’il faut advenir).
En regardant l’autre vivre, l’orbiteur devient metteur en scène (qui est dans le cadre? qui est hors champ? avec qui parle-t-on sur cette terrasse?). L’orbiting réactive les jalousies originaires (parentales, fraternelles ou sororales). L’autre le trompe de vivre, d’aimer, de s’amuser sans lui. Plus il regarde, plus il hallucine l’intrigue et plus il hallucine, moins il parle.
Notre époque a monétisé le regard (décompte de vues, d’impressions, pourcentage d’engagement). L’orbiting transforme la relation en métrique, on vérifie la persistance d’une présence par le compteur des vues. L’autre devient un spectre dans l’algorithme de nos vies, il hante la première ligne des visionnages. On connaît sa chaleur par sa proximité dans la liste des viewers. Il n’en sort pas un mot, mais un score.
Ce que l’orbiting nous dit, c’est la difficulté moderne à passer de l’image au langage, du signal à la parole, de la scène imaginaire au pacte symbolique. C’est la peine à consentir à la castration, c'est-à-dire à renoncer aux mille possibles pour le réel d’une rencontre. C’est l’attrait de l’hypnose d’un monde observable, où l’on croit qu’additionner des vues rend l’absence et le manque moins pénibles.


Commentaires