
Du 24 au 30 octobre, l’ONU célèbre la Semaine du désarmement, instituée en 1978 pour rappeler que la paix passe d’abord par la réduction des armes, non par leur accumulation. Un mot qui, depuis ses origines médiévales, relie la langue française à l’histoire des conflits et à l’idéal de paix.
En cette dernière semaine d’octobre, la Semaine du désarmement de l’ONU prend une résonance toute particulière. D’une part, Washington a posé au Hamas un ultimatum pour son désarmement, dans le cadre du plan de paix de Donald Trump à Gaza. D’autre part, le gouvernement libanais subit une pression américaine accrue pour désarmer le Hezbollah, pivot du dispositif iranien dans la région. Téhéran, lié avec ces deux formations, demeure au centre d’un affrontement global alors que ses infrastructures nucléaires ont été ciblées, en juin dernier, par une opération conjointe des États-Unis et d’Israël.
Dans ce contexte, le mot «désarmement» ne se cantonne plus aux traités du siècle dernier. Il incarne désormais une urgence politique et une remise en cause du monopole des armes. C’est aussi un appel à repenser la sécurité collective, dans un monde où les conflits, les armes nouvelles et les chaînes d’alliance redéfinissent sans cesse les frontières de la paix.
Un mot d’origine médiévale
Le terme «désarmement» apparaît au XVIᵉ siècle, selon le Dictionnaire de l’Académie française. Il est dérivé du verbe «désarmer», formé du préfixe privatif dés-, qui marque l’action d’ôter ou d’inverser, et du substantif issu du mot «armes» (du latin arma).
Son sens premier renvoie à l’action de priver un individu ou un groupe de ses armes, que ce soit dans un cadre militaire, après une capitulation, ou dans un contexte symbolique de reddition et d’apaisement.
Progressivement, le terme s’impose dans le vocabulaire du droit international, où il désigne «l’action de réduire ou de supprimer les forces armées», partiellement ou totalement, par décision unilatérale ou par accord multilatéral. On parle ainsi de «désarmement général, partiel ou unilatéral», ou encore de «conférence internationale sur le désarmement».
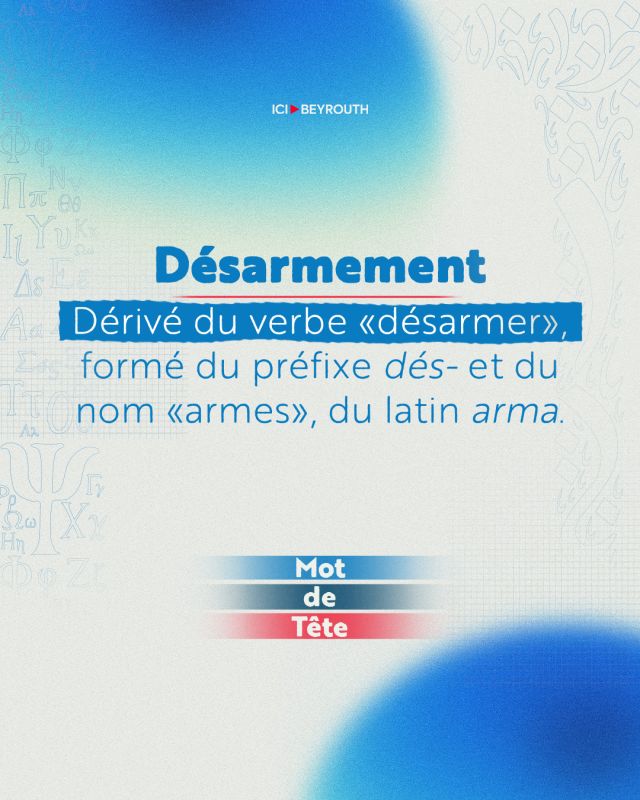
De la course aux armes à la course à la paix
Depuis la création de l’ONU en 1945, le désarmement constitue l’un des piliers du système international de sécurité. Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, au Japon, en 1945, ont fait naître un tabou mondial autour des armes nucléaires, dont la puissance destructrice reste sans équivalent.
Près de 13.080 ogives nucléaires subsistent encore aujourd’hui dans le monde, et plus de 2.000 essais ont été réalisés depuis 1945 – un rappel saisissant de la persistance de la menace.
Ce traumatisme historique a façonné l’architecture du désarmement moderne. Des traités majeurs ont jalonné cette quête de paix:
– la Convention sur l’interdiction des armes biologiques (1972) et la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1993),
– la Convention d’Ottawa, interdisant les mines antipersonnel (1997),
– le Traité sur le commerce des armes (2014), qui encadre les transferts internationaux d’armes conventionnelles.
Mais le désarmement ne se limite pas aux arsenaux de destruction massive: il concerne aussi les armes légères et de petit calibre, dont la prolifération nourrit les conflits, fragilise les États et compromet les Objectifs de développement durable (ODD).
Consciente de ces enjeux, l’Assemblée générale des Nations unies a instauré en 1978 la Semaine du désarmement, célébrée chaque année du 24 au 30 octobre – date anniversaire de la fondation de l’ONU. Elle vise à promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension des questions de désarmement, en associant gouvernements, ONG et citoyens.
Les gardiens du désarmement mondial
Au sein du système onusien, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité jouent un rôle central dans la mise en place des normes internationales visant à réduire les arsenaux, prévenir la prolifération et favoriser un usage responsable des technologies militaires.
Depuis 1983, ce travail est coordonné par le Bureau des Nations unies pour les affaires de désarmement (UNODA). Cet organe soutient le Secrétaire général, les États membres et la société civile dans leurs efforts communs pour renforcer la paix mondiale.
En 2018, le Secrétaire général, António Guterres, a redonné un souffle à cette ambition avec son plan baptisé «Assurer notre avenir commun». Ce programme repose sur quatre axes principaux:
– «Sauver l’humanité», en œuvrant pour un monde sans armes nucléaires;
– «Sauver des vies», en limitant l’usage et la prolifération des armes conventionnelles;
– «Préserver les générations futures», en encadrant les technologies d’armement émergentes;
– «Renforcer les partenariats, en mobilisant la société civile, les femmes et les jeunes.
Ainsi, le désarmement ne relève plus seulement du domaine militaire. Il s’affirme aujourd’hui comme un projet de société globale, au croisement de la sécurité, du développement durable et des droits humains.





Commentaires