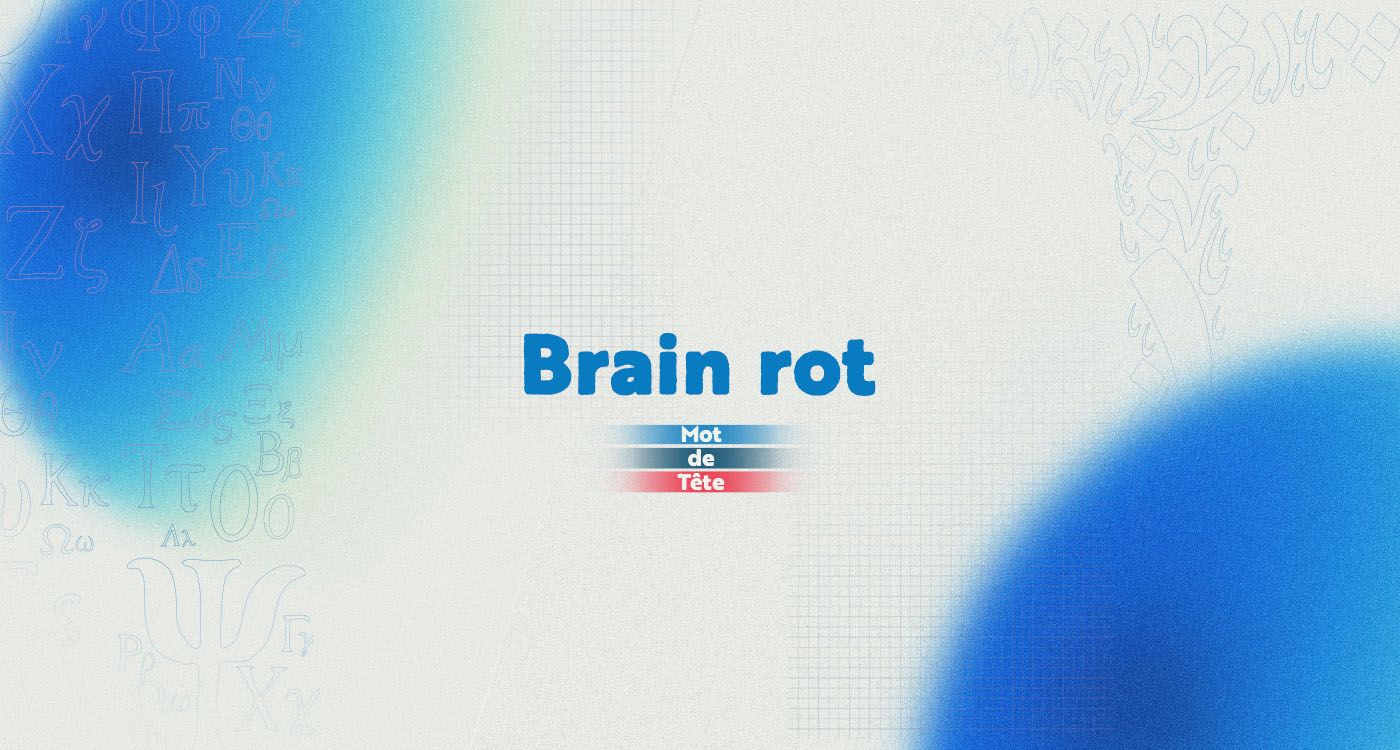
Le phénomène du brain rot interroge notre rapport aux écrans, aux mèmes et au langage. Entre ironie générationnelle et brouillage cognitif, un mot-clé pour comprendre l’impact culturel des contenus viraux sur nos cerveaux connectés.
Vous est-il déjà arrivé de «swiper» une page papier, comme si c’était un écran? Et si notre cerveau ne faisait plus la différence entre le réel et les automatismes forgés par nos écrans? Ce phénomène porte un nom: le brain rot.
Un mot venu du malaise numérique
Littéralement, brain rot signifie «pourriture du cerveau». L’expression, élue «mot de l’année 2024» par Oxford University Press, désigne l’effet supposé d’une surconsommation de contenus numériques jugés triviaux ou peu stimulants. Ce choix a été interprété comme un signal des inquiétudes croissantes face à l’exposition des enfants aux écrans, dans un contexte de débats sur les pratiques numériques des plus jeunes.
Le terme est également passé dans l’usage francophone sous des formes comme «abrutissement numérique» ou «écervelage», terme employé au Québec.
Le phénomène toucherait particulièrement la génération Alpha, née entre 2010 et 2025, première à avoir grandi entièrement dans un environnement numérique. Les contenus courts, absurdes et addictifs qui inondent TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels seraient en partie responsables d’un brouillage cognitif: baisse de l’attention, saturation d’informations, confusion entre références culturelles et réalité.
Si l’expression semble récente, son usage remonte en réalité à 1854. Dans Walden, son essai philosophique sur la société industrielle, Henry David Thoreau dénonçait déjà un «brain rot» intellectuel en comparant la négligence morale de ses contemporains à une maladie plus dangereuse que la pourriture des pommes de terre.
C’est cependant avec l’explosion de la culture Internet que brain rot a pris son essor. Après avoir circulé sur les forums et réseaux sociaux dès les années 2010, le mot devient viral en 2023, jusqu’à être consacré «mot de l’année 2024» à l’issue d’un vote réunissant 37.000 participants.
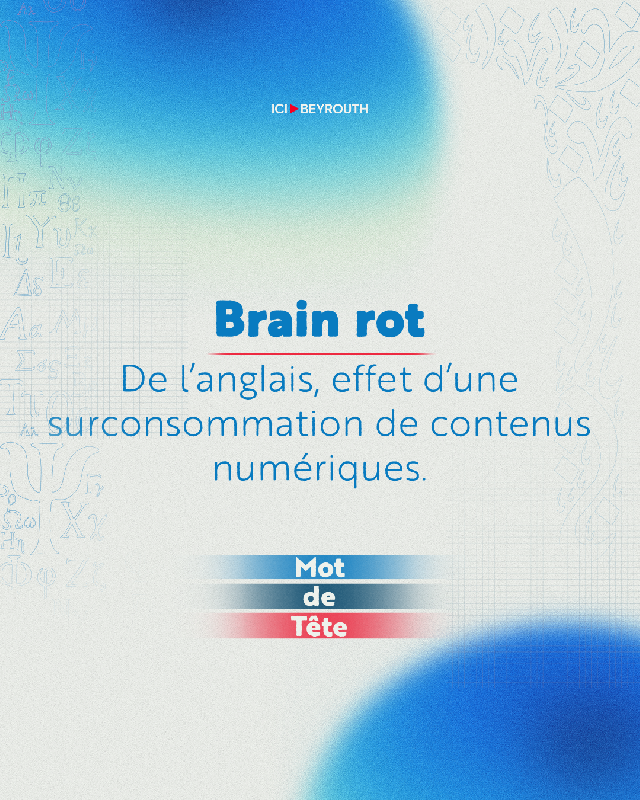
Quand les «réfs» prennent le contrôle
L’un des symptômes les plus visibles du brain rot, c’est l’usage compulsif de ce que les internautes appellent les «réfs», ou brain rot words. Ces références sont des mots, phrases ou mimiques issus de vidéos virales ou de mèmes, recyclés à l’infini dans la vie quotidienne.
On les retrouve dans des vidéos TikTok à succès, compilant des extraits cultes de YouTubeurs ou de stars du net. «Ok, let’s gooo», «Black à part?», ou encore le fameux «Ok génial» de Marion Cotillard à Squeezie. Autant de formules reprises en boucle dans les commentaires, les discussions, voire les interactions en face à face. Pour les plus jeunes, ces expressions deviennent des tics langagiers, parfois au détriment de leur propre capacité à formuler une pensée originale.
Entre déclin cognitif et plaisir partagé
Faut-il s’inquiéter du brain rot? Pas forcément, répondent certains chercheurs. Le terme, bien qu’alarmant, est aussi utilisé avec ironie par les générations concernées. Sur TikTok, brain rot est devenu un mème en soi, un clin d’œil aux absurdités assumées du quotidien numérique. Il reflète à la fois une lucidité et une résignation face à la puissance des plateformes.
Reste que, face à l’intensification des contenus générés par l’IA, des formats toujours plus courts et d’un vocabulaire formaté par les tendances, la frontière entre langage personnel et automatisme culturel devient de plus en plus floue.
Si votre premier réflexe face à un tableau ou une émotion est de citer un mème, peut-être est-il temps de réapprendre à penser sans filtre.





Commentaires