
Omniprésent dans le débat public, le mot «crise» semble devenu le passage obligé de tout discours sur le monde contemporain. Mais savons-nous encore ce qu’il signifie? Entre racines médicales, détournements politiques et inflation médiatique, retour sur un terme qui, à force d’être brandi, dit autant notre époque qu’il la brouille.
En mars 2024, le président français Emmanuel Macron évoquait la «crise de civilisation» pour qualifier un ensemble de défis contemporains: guerre en Ukraine, terrorisme, montée de l’extrême droite, changement climatique. Certains y ont vu un diagnostic lucide, d’autres une façon alarmiste de tout amalgamer. Cet usage globalisant du mot «crise» interroge. À force de vouloir tout nommer par ce seul terme, ne risque-t-on pas de le vider de son sens?
Un mot venu du corps
À l’origine, la crise est une affaire médicale. Le mot vient du grec krisis, qui signifie «décision». Dans la Grèce antique, c’est le moment critique dans l’évolution d’une maladie, celui où tout se joue: guérison ou aggravation.
Le mot entre dans le français savant au XVe siècle, d’abord dans les traités de médecine, pour désigner ce tournant où le corps décide de vivre ou de flancher.
Au XVIIIe siècle, Rousseau écrit: «Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions.» Le mot a quitté le cabinet du médecin pour entrer dans l’histoire.
Avec le temps, le sens s’élargit. On parle bientôt de «crise de nerfs» ou de «crise de jalousie», puis, par glissement, de crises sociales, politiques, économiques.
Quand tout vacille
Mais que dit-on vraiment quand on parle de crise? Une rupture soudaine, un moment de bascule. La crise n’est pas un long malaise, ni une lente dégradation. C’est un choc. Un nœud de tensions qui éclate, et qui oblige à prendre une direction.
L’Académie française recommande ainsi d’éviter l’emploi de «crise» pour parler de phénomènes durables, comme les problèmes climatiques par exemple. «L’on s’efforcera de le réserver à des évènements précis et limités dans le temps.»
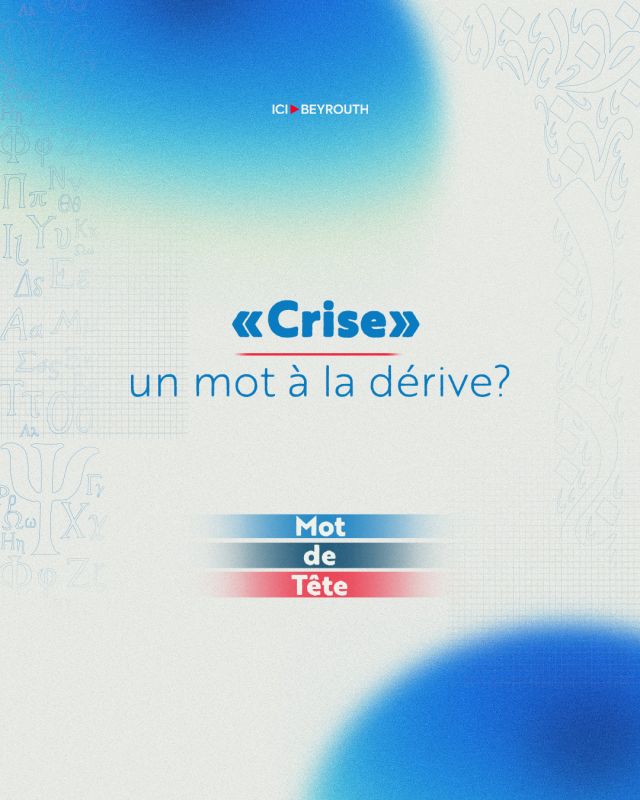
Un révélateur de valeurs
La crise oblige à trancher, elle dit ce que nous sommes prêts à perdre, ou à sauver. En ce sens, la crise n’est pas seulement menace, mais aussi fécondité.
Qu’il s’agisse de l’attaque du 7 octobre 2023 et de la guerre qui a suivi, de la guerre en Ukraine, au Soudan ou au Yémen, chaque crise confronte les sociétés à leurs limites et les contraint à repenser leurs repères moraux et politiques.
Peut-être est-il temps, justement, de revenir à l’étymologie: la décision. Car si la crise est bien ce point de bascule, elle nous rappelle qu’il est encore possible de choisir.





Commentaires