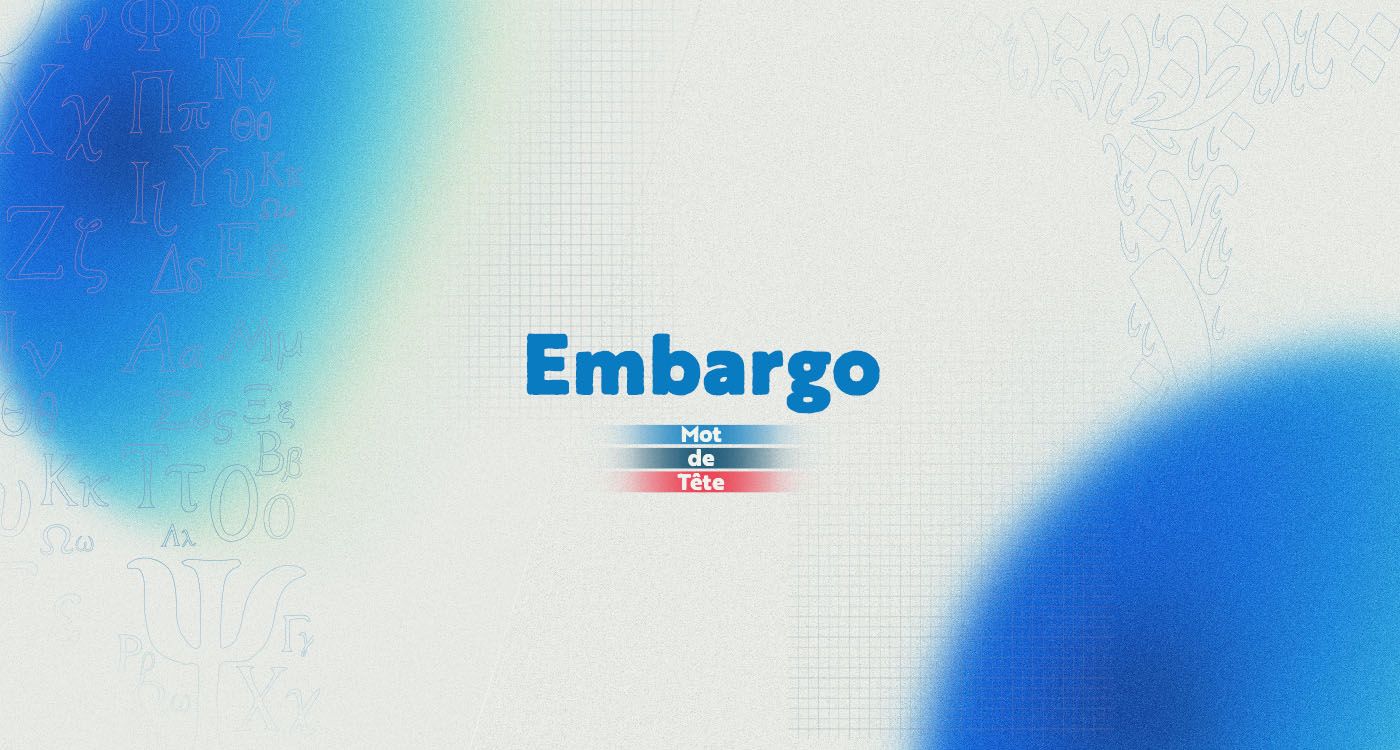
Arme silencieuse de la diplomatie moderne, l’embargo n’a jamais été autant utilisé qu’aujourd’hui. Du bras de fer technologique entre Washington et Pékin aux sanctions multiformes visant l’Iran, les grandes puissances déplacent leur affrontement du terrain militaire vers celui des échanges, des ports et des circuits financiers. Derrière ce mot d’origine espagnole se cache désormais l’un des outils les plus redoutés – et les plus discutés – de la géopolitique contemporaine.
Le 1er janvier 2025, l’administration américaine a renforcé son embargo technologique contre la Chine, doublant les surtaxes sur une large gamme de produits stratégiques – des semi-conducteurs aux équipements industriels. Pékin a répliqué dix jours plus tard avec une série de contre-mesures visant les produits agricoles américains, provoquant un nouvel épisode dans la guerre économique sino-américaine.
Par ailleurs, l’Iran, sous «pression maximale», subit des sanctions pour son soutien au Hamas, ses livraisons d’armes à la Russie, son appui aux Houthis et ses violations des droits de l’homme.
L’embargo est aujourd’hui un levier de puissance, une pression politique et un champ d’affrontement géopolitique.
Aux origines du mot: empêcher, entraver, séquestrer
Le mot «embargo» entre en français au XVIIᵉ siècle. Il est emprunté à l’espagnol embargo, signifiant «empêchement, obstacle, séquestre», lui-même dérivé du verbe embargar, «empêcher, entraver». Ce verbe est apparenté au latin vulgaire imbarricare, formé sur barra, «barre».
À l’origine, le terme possède un sens strictement maritime. Il désigne l’acte par lequel un État retient dans ses ports les navires d’un pays étranger pour faire pression sur lui. Dès 1626, Richelieu évoque déjà un embargo destiné à bloquer la circulation de marchandises.
Au XVIIIᵉ siècle, le sens s’élargit: «mettre l’embargo» signifie désormais interdire l’exportation ou la libre circulation de biens stratégiques: blé, pétrole, matériel militaire.
Le mot est aussi utilisé au figuré: «mettre l’embargo sur une information», c’est en retarder la diffusion.
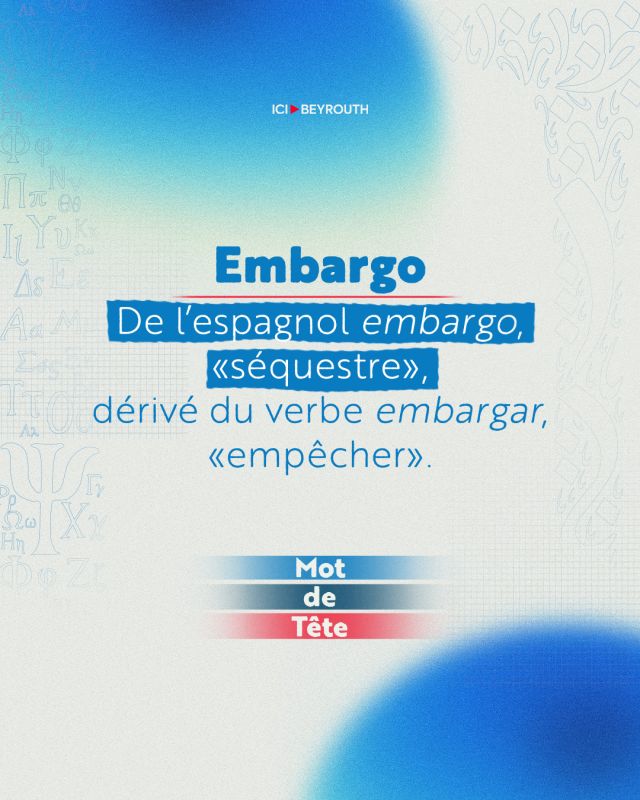
L’embargo, une arme politique
Aujourd’hui, l’embargo désigne l’une des mesures les plus radicales de la boîte à outils diplomatique. C’est une sanction, pouvant être décidée par un État souverain, une organisation internationale ou une coalition d’États.
Son objectif: contraindre, isoler, asphyxier ou punir un acteur étatique ou non étatique, sans recourir à la force militaire.
Selon les données compilées par Castellum.AI, l’usage des sanctions a littéralement changé d’échelle durant les dernières décennies. Dans les années 1990, elles ne visaient que quelques États, alors qu’en 2024, près de 27% des pays du monde étaient sous sanction.
Le même rapport souligne que les États-Unis ont imposé, à eux seuls, plus de sanctions en 2024 que toutes les autres grandes juridictions réunies, confirmant leur domination en la matière. Cette suprématie tient, en grande partie, au rôle stratégique de l’Office of Foreign Assets Control (Ofac), devenu l’un des leviers les plus puissants de la politique étrangère américaine.
Instrument de pression ou d’ingérence?
À double tranchant, l’embargo oscille ainsi entre levier politique et instrument d’ingérence. Conçu pour infléchir des comportements étatiques et préserver un ordre international, il sert aussi – de plus en plus – des stratégies de puissance, redessine les sphères d’influence et accélère la formation de nouveaux blocs géopolitiques.
Les États ciblés apprennent à contourner la contrainte, souvent en forgeant des alliances inédites. Des coopérations alternatives naissent.
Reste alors une question centrale: dans un monde où l’économie devient champ de bataille, l’embargo protège-t-il réellement la paix… ou contribue-t-il à redéfinir la géopolitique du pouvoir?





Commentaires