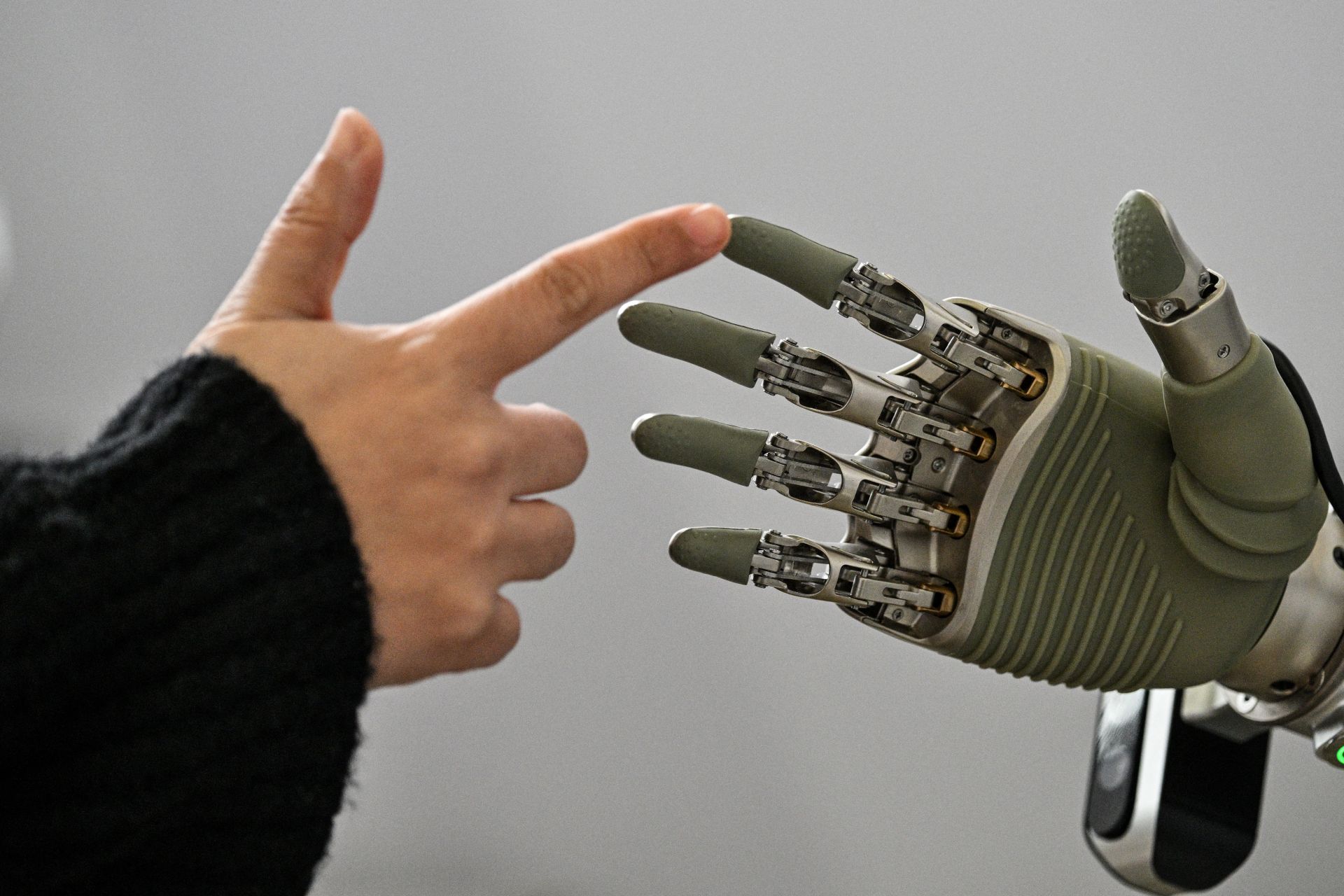
Loger des puces et des serveurs dans l’espace, voilà l’objectif affiché par les géants et les start-up du secteur technologique, qui y voient une réponse aux contraintes actuelles d’approvisionnement en énergie.
«L’idée, c’est que cela aura bientôt beaucoup plus de sens de construire des centres de données (data centers) dans l’espace que sur terre», a clamé, fin octobre, Philip Johnston, patron de la jeune pousse Starcloud, lors de la conférence FII à Riyad.
Depuis quelques mois, les annonces se succèdent, la dernière en date, mardi, pour Google et son projet Suncatcher, qui ambitionne de lancer deux premiers satellites tests d’ici début 2027.
Vendredi, Elon Musk avait assuré que SpaceX serait en mesure de déployer ses propres «data centers» 2.0 grâce à la version 3 de son satellite Starlink, attendue en 2026.
C’est un lanceur SpaceX qui a d’ailleurs mis sur orbite, dimanche, le premier satellite de Starcloud.
La plupart de ces programmes ont une architecture similaire, à savoir une constellation de satellites en orbite basse (LEO) et proches les uns des autres (100 à 200 m seulement pour Google) pour assurer une connexion fiable entre eux. Le lien avec la terre sera assuré par des lasers.
«Nous avons déjà la preuve que c’est possible», explique Krishna Muralidharan, professeur d’ingénierie à l’université d’Arizona, qui travaille sur le sujet.
Il estime que la technologie pourrait être viable commercialement d’ici «2032 à 2035». Pour le fondateur d’Amazon et actionnaire majoritaire de la compagnie aérospatiale Blue Origin, Jeff Bezos, la fourchette est comprise entre dix et vingt ans.
Tous les aspects techniques de l’opération ne sont pas encore résolus, notamment la résistance des processeurs au niveau élevé de radiations dans cet environnement.
Les sceptiques évoquent aussi les températures extrêmes, la difficulté de maintenir ces constellations en état et la présence de débris et de micrométéorites susceptibles d’endommager l’infrastructure.
«Il va falloir de l’ingénierie innovante», admet Christopher Limbach, professeur assistant d’ingénierie à l’université du Michigan, «mais cela n’aura d’impact que sur le budget, pas sur la faisabilité technique».
L’espace présente de multiples avantages par rapport à la terre, en premier lieu l’alimentation, car un satellite peut être mis en orbite héliosynchrone, ce qui garantit à ses panneaux solaires de la lumière en continu.
En outre, un capteur photovoltaïque reçoit, dans ces conditions, environ huit fois l’énergie solaire de son équivalent sur terre.
L’accès à une source d’énergie illimitée et déjà disponible fait saliver la tech, dont les besoins croissants en électricité, pour développer l’intelligence artificielle (IA) notamment, sont aujourd’hui contraints par une capacité installée insuffisante aux États-Unis.
Autre point fort : la mise en service d’un centre de données dans les cieux ne requiert ni l’acquisition d’un terrain ni l’octroi d’autorisations réglementaires, et n’est une nuisance pour personne.
– Économiquement viable –
Sur le plan climatique, Philip Johnston évalue les émissions d’un centre de données spatial à 10 % seulement d’un site de même taille au sol, mais ce calcul ne prend pas en compte le lancement des satellites, aux effets conséquents.
Quant à l’eau, dont la consommation massive par les centres de données préoccupe les défenseurs de l’environnement, il n’y en aura pas besoin dans le ciel.
Le système sera semblable à celui des stations spatiales, qui ne nécessite que du liquide de refroidissement en circuit fermé (donc sans évaporation) et des radiateurs d’évacuation.
«La vraie question, c’est de savoir si l’idée est économiquement viable», cite Christopher Limbach.
Jusqu’ici, le principal obstacle au déploiement de puces et serveurs dans l’espace était le coût de transport, mais l’arrivée de la mégafusée Starship de SpaceX, à une date encore indéterminée, doit changer la donne.
Ce mastodonte pourra emmener de quatre à sept fois la charge maximum de la fusée vedette de SpaceX, la Falcon 9, et sera, en outre, totalement réutilisable.
Ce nouveau véhicule devrait diviser la facture par au moins 30.
«À ce prix-là», a écrit mardi Travis Beals, à la tête du projet Suncatcher, «le coût de lancement et de la gestion d’un centre de données dans l’espace pourrait devenir comparable» à celui d’un site de capacité identique sur terre.
«Pour la première fois, on peut imaginer de nouveaux modèles économiques pour l’espace ou en réinventer d’anciens», considère Christopher Limbach.
Par Thomas URBAIN, AFP



Commentaires