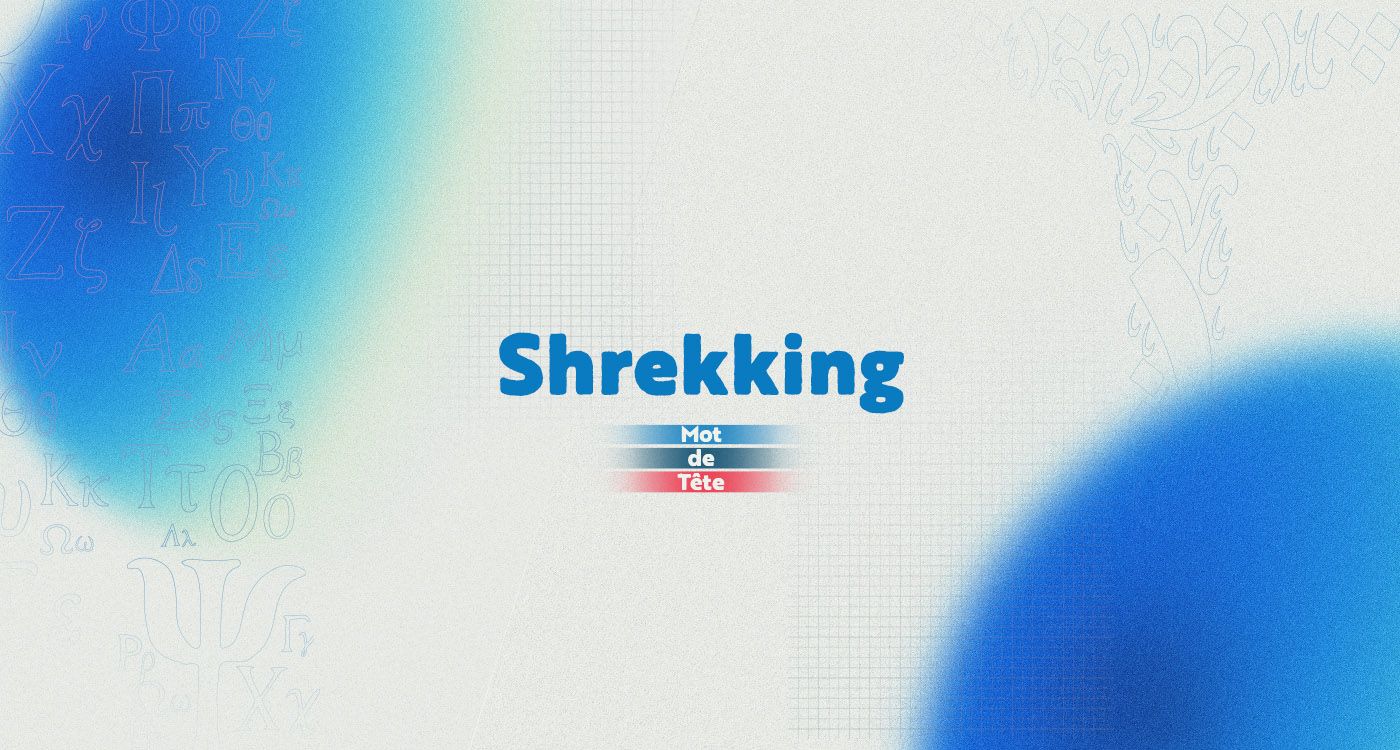
Né sur TikTok, le terme shrekking mélange culture pop et désillusion sentimentale. Derrière ce mot ludique se cache une réalité bien plus sombre: la façon dont la génération Z tente de naviguer entre amour, risque et déception à l’ère des applis de rencontre.
Que se passe-t-il lorsque les contes de fées se heurtent aux dures réalités des rencontres modernes? Bienvenue dans l’univers du shrekking, le tout dernier terme de la génération Z qui fait sensation sur TikTok et Instagram.
À première vue, le mot semble léger, presque attendrissant. Après tout, qui n’a pas de sympathie pour Shrek, l’ogre vert au grand cœur, héros des films d’animation? Mais en langage amoureux, le shrekking n’a rien de romantique: il rime surtout avec déception.
Quand l’ogre ne tient pas ses promesses
Concrètement, le shrekking consiste à sortir avec quelqu’un qui ne nous attire pas vraiment, dans l’idée que cette personne sera plus attentionnée qu’un·e partenaire correspondant aux standards de beauté. C’est un peu rejouer le pari de la princesse Fiona: donner sa chance à l’ogre pour décrocher son «happy end».
Mais dans bien des cas, le scénario se retourne. On ne gagne pas une histoire enchantée, on se fait shrekker, c’est-à-dire trahir ou blesser par celui ou celle qu’on croyait «sûr·e».
Des spécialistes des relations rappellent que ce comportement n’a rien de neuf: beaucoup ont tenté, un jour, de privilégier la gentillesse ou la stabilité à l’attirance. Ce qui change aujourd’hui, c’est la tournure plus cynique: l’idée que «sortir avec moins bien» garantirait automatiquement un meilleur traitement. Une illusion que la réalité dément bien souvent.
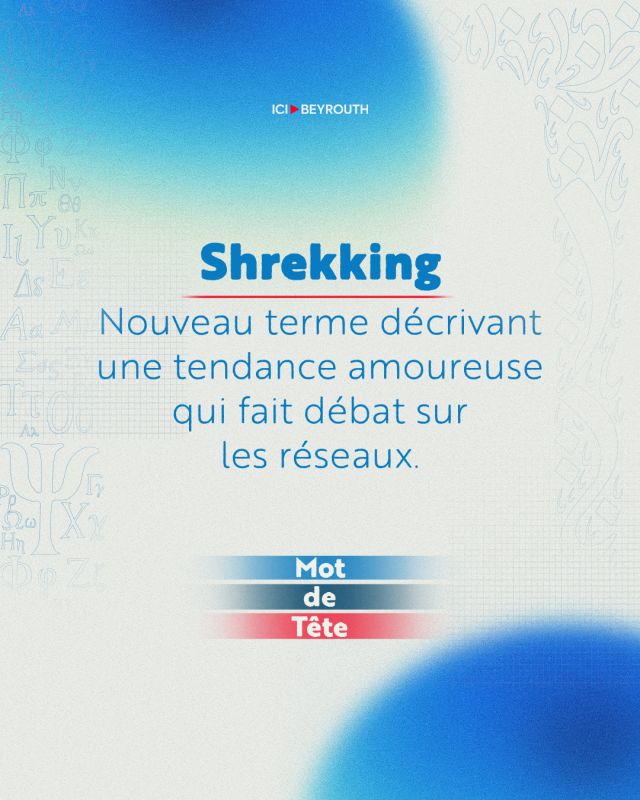
Au-delà du conte de fées
Au fond, le shrekking n’est qu’un mème. Mais il met en lumière un piège bien réel: croire qu’en «jouant la sécurité», on s’épargne les blessures du cœur. Certes, l’apparence ne fait pas tout, mais elle ne protège pas non plus des désillusions.
Ce qui compte vraiment reste immuable: le caractère, la communication, la compatibilité. Et peut-être est-ce là la vraie morale de ce conte moderne: les relations solides ne naissent pas d’attentes revues à la baisse, mais d’une exigence plus forte en matière d’honnêteté et de connexion authentique.
Un lexique de plus en plus fourni
Le shrekking n’est que la dernière entrée d’un dictionnaire amoureux en pleine expansion. Les réseaux sociaux regorgent désormais de termes inventés pour nommer des comportements qui existaient déjà, mais que l’on peine à décrire auparavant.
Ainsi, le banksying, inspiré de l’artiste de rue Banksy, décrit le retrait progressif d’une relation, sans jamais l’annoncer clairement. Quand la rupture survient, l’un des deux a déjà décroché, laissant l’autre désorienté.
Autre image parlante: le monkey barring. À l’instar d’un singe qui s’agrippe à une branche avant d’en lâcher une autre, ce mode consiste à rester dans une relation tout en cherchant activement la suivante, afin de ne jamais se retrouver seul.
D’autres expressions révèlent des formes de dissimulation ou de manipulation. Le pocketing consiste à cacher son partenaire, à ne jamais l’intégrer dans sa vie sociale ou familiale. Le cookie jarring désigne l’accumulation de partenaires de «réserve» au cas où la relation principale échoue. Le plus corrosif reste peut-être le ghostlighting, mélange de ghosting et de gaslighting: disparaître sans explication, puis revenir en niant l’absence ou en rejetant la faute sur l’autre.
Une langue née du désenchantement
Ces mots peuvent paraître ludiques, mais ils révèlent surtout la fragilité des relations intimes à l’ère numérique. Face à la complexité des relations médiatisées par les applis et les réseaux, la génération Z s’invente un nouveau langage pour dire ses blessures. Nommer, c’est déjà partager, et peut-être commencer à repenser sa façon d’aimer.





Commentaires