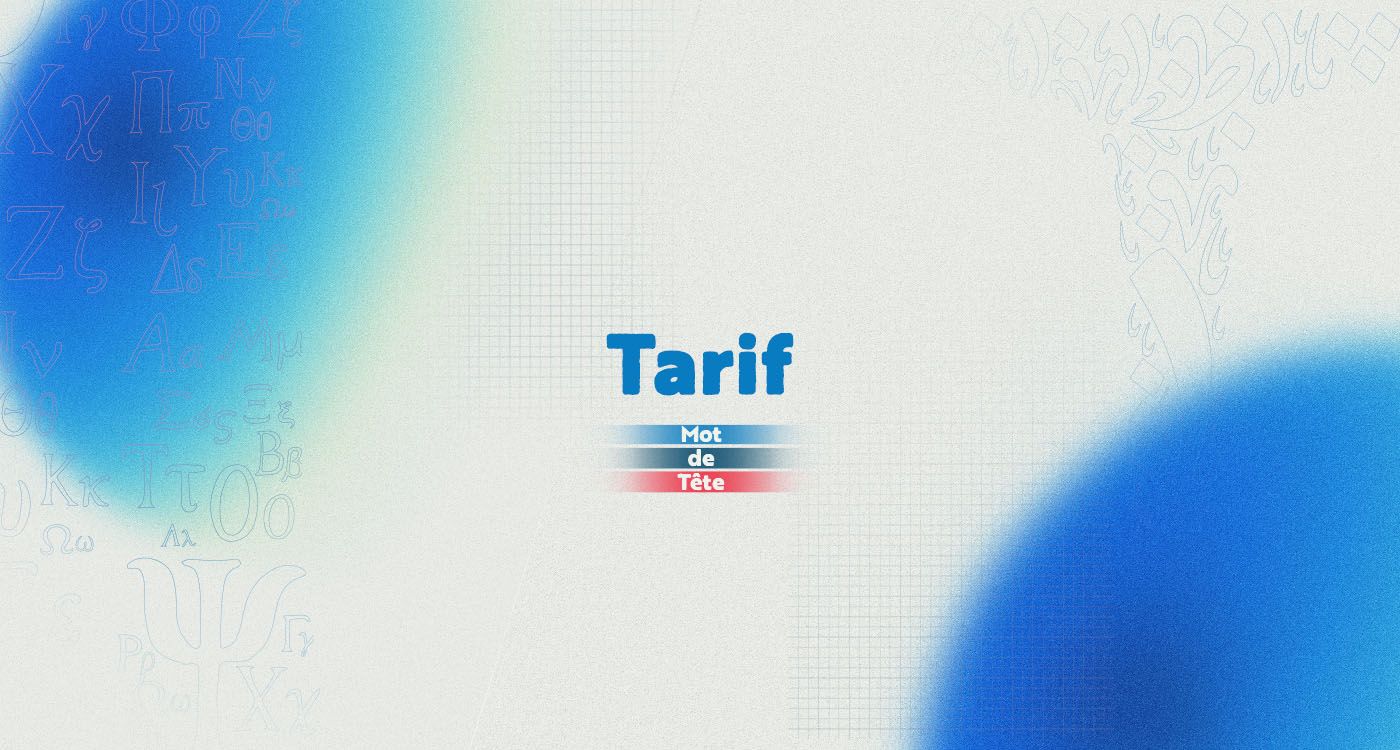
À l’heure où les droits de douane refont surface dans les discours politiques, le mot «tarif» résonne bien au-delà du commerce international. D’origine arabe, passé par l’Italie, ce terme raconte une histoire de contrôle, de normes et de pouvoir, jusque dans notre quotidien.
Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a relancé avec fracas la guerre économique par les tarifs. Réactivant les mesures protectionnistes de son premier mandat, il a multiplié les annonces de surtaxes douanières visant à rééquilibrer, selon ses termes, les échanges commerciaux avec la Chine, l'Union européenne et même le Canada.
Dans les discours officiels et les débats médiatiques, le mot «tarif» s'est imposé comme un marqueur de souveraineté économique et un levier de pression diplomatique. Mais d'où vient ce mot aux airs techniques, et comment en est-il venu à s'immiscer dans notre quotidien?
Aux origines du tarif: dire, informer, fixer
Le mot «tarif» est apparu en français à la fin du XVIe siècle sous les formes féminines «tariffe» ou «tarife», avant que son genre ne bascule au masculin au XVIIe siècle, ainsi que sa graphie vers la forme «tarif».
Il est issu de l’italien tariffa, lui-même emprunté à l’arabe taʿrīfa, dérivé du verbe arrafa qui signifie «informer, faire connaître». L’idée première est donc celle d’une notification officielle.
C’est ce que l’on retrouve dans l’emploi originel du mot, désignant un tableau établi par une autorité, listant les prix, droits ou taxes à acquitter pour certaines marchandises ou services. Rapidement, le «tarif» s’est associé aux taxes douanières, ces droits à payer à l'importation ou à l’exportation.
Fait intéressant, la ville portuaire espagnole de Tarifa, située à l’emplacement stratégique du détroit de Gibraltar, est parfois associée à l’origine du mot, en raison de son rôle historique dans la perception de péages sur les navires de passage durant la période mauresque. Toutefois, la majorité des linguistes s’accorde à dire que cette ressemblance est en grande partie fortuite, et que la véritable origine du mot provient de la racine verbale arabe.

De l’économie à la vie quotidienne
Au fil des siècles, l’usage du mot «tarif» s’est largement diversifié, suivant l’évolution des sociétés et des rapports économiques.
À partir du XVIIe siècle, il s’étend à tout barème officiel ou même contractuel fixant le prix d’un service ou d’un travail: salaires professionnels (tarif horaire), actes médicaux (tarif conventionnel), prix des transports (plein tarif, demi-tarif) ou encore abonnements et forfaits divers. Le mot devient ainsi synonyme de «prix» dans l’usage courant.
Par ailleurs, dès le XVIIIe siècle, il prend un sens figuré, désignant un «système d’évaluation», notamment des fautes ou des peines. «C’est le tarif!», devient une expression familière pour dire qu’une punition est méritée ou conforme aux usages.
Aujourd’hui, le terme circule dans les sphères économique, politique, juridique, sociale mais aussi populaire et médiatique. Cela illustre la capacité du mot à formaliser non seulement des prix, mais aussi des jugements sociaux et moraux.
Un mot qui juge
Derrière sa froideur de chiffre, «tarif» est un mot qui organise les rapports humains: il fixe, classe, ordonne. Dans la logique du marché, il donne un prix aux choses. Mais dans le monde social, il peut également figer les personnes dans des catégories: tarif étudiant, tarif senior, tarif non conventionné... Il dit ce que l’on vaut, ou ce que l’on doit.
En cela, «tarif» n’est pas seulement un outil de gestion; c’est un langage de pouvoir. Il est le reflet d’une société où tout se compte, où l’on veut tout mesurer. Un mot de chiffres, non sans valeur symbolique.





Commentaires