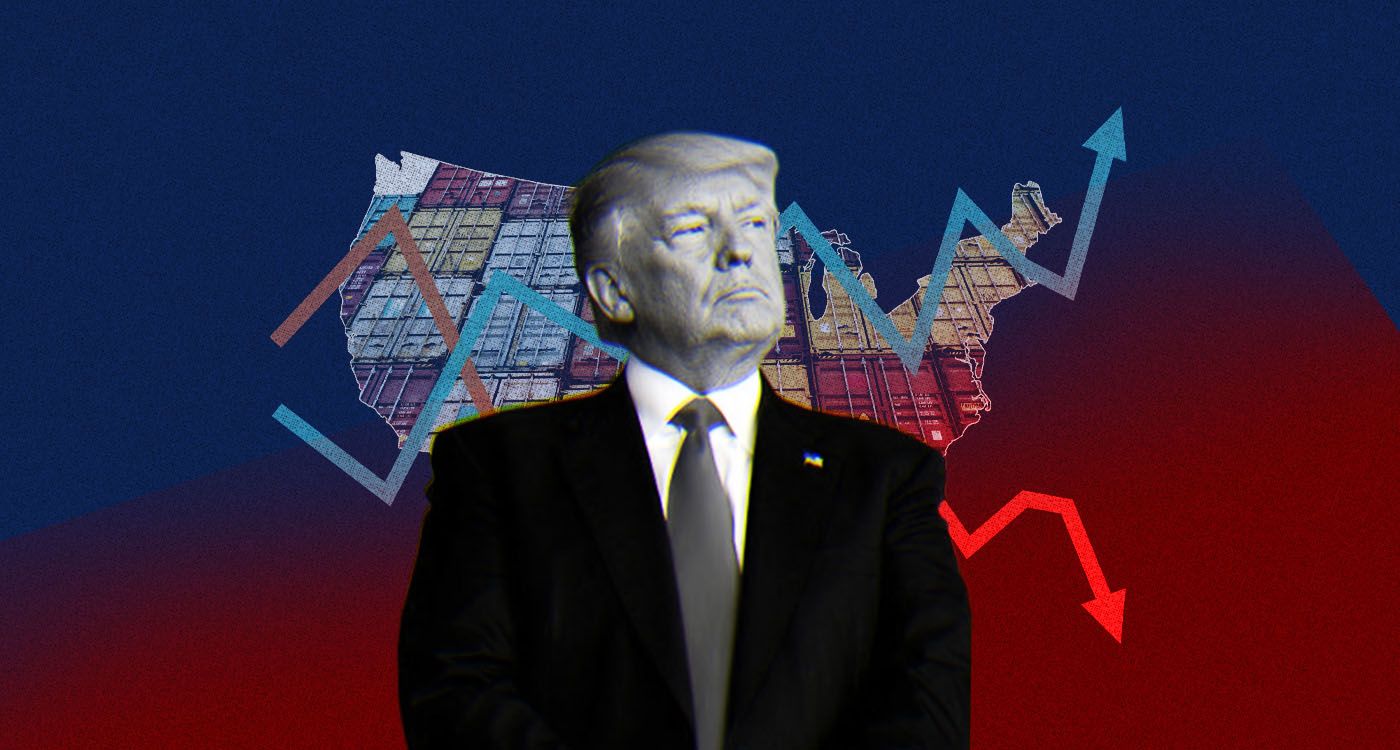
Il avait promis de «Make Tariffs Great Again», il est en passe de réussir. Depuis sa réélection, Donald Trump s’attaque à son cheval de bataille préféré: les droits de douane. Et cette fois, il ne plaisante pas. Dès le 7 août 2025, les partenaires des États-Unis qui n’ont pas signé d’accord commercial risquent jusqu’à 50% de surtaxes. Résultat? Une course contre-la-montre mondiale, façon «Deal or No Deal».
À la veille du 7 août, l’administration Trump peut se targuer d’avoir imposé sa vision du commerce international à coups de tweets, de menaces tarifaires… et de résultats. Sous la bannière «America First», une nouvelle vague d’accords douaniers redessine les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. Entre partenaires qui ont signé sans (trop) broncher et recalés de la Trump Tower, petit tour d’horizon des gagnants, des perdants et des secoués.
Les bons élèves: ceux qui ont signé (presque) sans broncher
Le Japon, accord signé, 15% de droits. Signé le 23 juillet, l’accord avec Tokyo sauve l’industrie automobile nippone et offre à Trump une victoire de poids: 550 milliards d’euros d’investissements rapatriés aux États-Unis. En bonus, le riz américain fait désormais partie du menu au Japon.
La Corée du Sud, accord signé, 15% de droits. Conclu le 29 juillet, l’accord accorde à Séoul des exemptions stratégiques sur les semi-conducteurs et les écrans OLED (ouf, les smartphones respirent). En échange: davantage de gaz américain, plus d’usines Samsung sur le sol américain et même une coopération portuaire, selon le ministère sud-coréen du Commerce.
L’Union européenne, accord de principe, 15% de droits
Annoncé le 27 juillet, l’accord n’est pas encore signé. Les Européens espèrent en tirer davantage (Emmanuel Macron dénonce un «manque de puissance»). Les secteurs aéronautique et pharmaceutique seraient épargnés, en échange d’achats massifs d’énergie américaine, selon RFI et l’Associated Press.
Le Royaume-Uni, accord de principe, 10% de droits. Premier à signer un «cadre général» dès le 8 mai, Londres peine toujours sur les détails. L’acier et les services numériques coincent. Keir Starmer a même dû se rendre en Écosse… chez Trump pour négocier.
Vietnam, accord flou, 20% de droits. Officiellement annoncé sur Truth Social, l’accord semble avoir été imposé. Surprise: les produits chinois transitant par le Vietnam écopent de 40% de droits, un signal fort adressé à Pékin.
Chine, trêve tarifaire, 30% toujours en vigueur. Après un bras de fer éclair en mai (avec un pic de 145% de taxes américaines), la tension redescend. Depuis le 12 juin, un accord de principe est à l’étude, sans signature pour l’instant, mais en bonne voie, selon Bloomberg.
Les recalés de la Trump Tower
Le Canada, menace de 35% de droits. Ancien allié devenu «51e État» selon Trump, Ottawa est dans le collimateur. Pas d’accord en vue. Les tensions sur la Palestine et le refroidissement diplomatique pèsent lourd, selon Truth Social.
Le Mexique, menace de 30%, trêve prolongée de trois mois. Accusé de tous les maux (migrants, fentanyl), le Mexique négocie un sursis. Claudia Sheinbaum discute encore avec Trump. L’enjeu est de taille: le Mexique est le deuxième exportateur vers les États-Unis.
Le Brésil jusqu’à 50% de droits? Trump n’a pas digéré la mise en accusation de Bolsonaro, son «ami». Lula résiste et promet de défendre la souveraineté brésilienne. Résultat: surtaxes XXL à venir, d’après RFI.
L’Inde, 25%, sanctions en prime. Trump punit l’amitié russo-indienne et s’agace des barrières agricoles maintenues par New Delhi. Résultat: pas d’accord, et plus de taxes, selon Reuters.
L’Afrique du Sud, 30% et polémique raciale. Accusée par les cercles pro-Trump de «génocide blanc», l’Afrique du Sud subit 30% de surtaxes. En réponse, 59 fermiers blancs ont été accueillis comme réfugiés économiques aux États-Unis, selon AP.
Le Lesotho,15%, état d’urgence textile. Petit pays, grandes conséquences: d’abord menacé de 50%, le Lesotho a obtenu un tarif réduit. Mais le secteur textile s’effondre, poussant le gouvernement à déclarer l’état d’urgence le 9 juillet.
Si l’effet immédiat est tangible, la stratégie «à la Trump» laisse cependant planer un doute sur la durabilité des relations commerciales dans un monde où l’équilibre repose de plus en plus sur les rapports de force.

Commentaires