
On a le sentiment que la guerre bute sur des impasses et que l’échange là-dessus s’arrête inopportunément alors que les objectifs sont loin d’être atteints. Le théâtre opérationnel est toujours en place, les acteurs en lice et l’épilogue incertains. Que faire pour clore le chapitre de la guerre dans un champ de ruines où plus rien ne reste, et où la qualité des interlocuteurs est plus controversée que jamais? Le régime iranien serait-il l’interlocuteur avec qui il faudrait négocier une fin de guerre, conclure un traité de paix, forcer à la libéralisation et au respect des droits humanitaires? Autant de questions auxquelles se refuse de répondre un régime belliqueux, aux visées impériales et résolument opposé aux normes de l’État de droit et de sa métanarrativité.
Pourquoi ne faudrait-il pas revenir sur toutes ces considérations qui s’avèrent aporétiques au point de départ, finaliser la défaite et envisager l’après-guerre avec les acteurs de l’opposition si l’on veut à la fin d’une dynamique conflictuelle qui se nourrit d’un projet de domination impériale? Le dilemme est pourtant lesté d’ambiguïté vu les impondérables stratégiques qui vont succéder à la fin du régime islamique, à l’incertitude d’une alternance démocratique et à l'éventuelle implosion d’un vaste pays situé aux interfaces de plusieurs sous-continents et aux bigarrures ethnoconflictuelles qui vont remettre en question des équilibres géopolitiques hautement fragilisés.
Il est inconcevable de négocier une fin de guerre sans épilogue militaire et de se méprendre sur la nature des négociations. C’est pour cela qu’il faudrait sceller la défaite militaire que le régime iranien refuse de reconnaître alors que sa marge de manœuvre s’est considérablement réduite. La destruction massive de ses infrastructures nucléaires, quelles que soient les conjectures; la défaillance d’un régime dysfonctionnel, délégitimé et systématiquement infiltré par le Mossad et la CIA; et le contrôle des espaces aériens réduit à néant sa capacité à pouvoir remettre en cause les nouveaux rapports de force.
D’où la difficulté à pouvoir se redonner une titulature, surtout que la contestation interne va croître au fur et à mesure que le processus de décomposition va avancer. Quels que soient les soi-disant sursauts nationalistes, ils finiront par s’effilocher au profit d’un état de décomposition généralisée où plus rien ne tient. Ce régime n’a plus de lettres de créance et on ne voit même pas d’issue à cette crise de crédibilité diffuse qui atteint sa raison d’être.
On revient au sujet de départ, celui de l’objet des négociations avec un régime totalitaire qui, quoique défait, s’installe dans le déni et entend se repositionner comme interlocuteur obligé sur la scène internationale, alors qu’il poursuit une politique de répression à l’intérieur du pays. Sur quoi faudrait-il négocier: la reprise de contrôle des sites, leur restitution, les rapports avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), les dérogations statutaires et de fait, la politique des louvoiements continus, alors qu’il récuse toute sorte de contrôle et de normalisation.
Somme toute, il faudrait décider des encadrements statutaires, politiques et sécuritaires avec un régime totalitaire qui ne reconnaît pas les règles du jeu et qui entend poursuivre la politique des équivoques intentionnelles. Quels que soient les aléas d’un effondrement brutal du régime, la communauté internationale n’est plus en mesure de s’accommoder d’autant de contradictions et de ne pas mettre en danger la paix internationale et régionale.
En s’opposant à toute normalisation sur le plan international, le régime iranien s'inscrit dans une démarche de subversion résolue, tout en sachant qu'il est désormais dépourvu de toutes les ressources qui lui permettent de la continuer. Israël et les États-Unis sont sommés de répondre aux multiples défis d'un conflit aux facettes multiples. La nature symptomatique de ce conflit et ses métonymies nous renvoient à des enjeux de structure et à des dynamiques transversales de déploiement. Il est hors de question de laisser tous ces problèmes en suspens alors que les champs de bataille sont loin d’être clos. L’interdépendance des enjeux ne peut pas faire l’économie d’une approche d’ensemble.
Autrement, la fin de cette guerre dépend d’un schéma d’ensemble dû à la politique iranienne des «plateformes opérationnelles intégrées», de la politique israélienne d’enrayage systématique et des nouvelles dynamiques géostratégiques qui en ont émané. La destruction du Hamas et ses effets conjugués tant sur les plans militaire et humanitaire, la débilitation progressive du régime syrien et sa fin, la destruction du Hezbollah, et la politique des endiguements fermes tant au Liban qu’en Irak et au Yémen, pavent désormais la voie à des régimes sécuritaires à géométrie variable et aux configurations mutantes comme en témoignent les situations respectives en Syrie et au Liban. Sinon, la capacité de projection militaire sur des théâtres opérationnels aussi éloignés que l’Irak, le Yémen et l’Iran atteste la recomposition des régimes sécuritaires sur une base déterritorialisée. On ne voit pas comment cette guerre finira sans de nouveaux rapports de force et sans l'émergence d'un ordre politique alternatif.


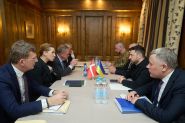

Commentaires