
Après des mois de tensions diplomatiques, Paris et Alger affichent leur volonté de tourner la page. La visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger marque la reprise officielle de la coopération bilatérale, suspendue depuis l’été 2024 sur fond de divergences autour du Sahara occidental, de la politique migratoire et de la liberté d’expression.
Huit mois de tensions diplomatiques ont conduit la France et l’Algérie à amorcer un rapprochement, concrétisé par la visite du ministre français Jean-Noël Barrot à Alger, le 6 avril.
Les relations entre la France et l’Algérie, façonnées par une histoire coloniale douloureuse, ont toujours été marquées par des hauts et des bas. Mais la crise qui a éclaté en 2024 a pris une ampleur inédite. En juillet, le président français, Emmanuel Macron, reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, provoquant la colère d’Alger, soutien historique du Front Polisario. Ce mouvement indépendantiste, soutenu par l’Algérie depuis les années 1970, revendique l’autodétermination du Sahara occidental, un territoire majoritairement contrôlé par le Maroc mais considéré par l’ONU comme non autonome. L’Algérie dénonce alors un “changement de doctrine” de Paris, contraire au droit international, et rappelle son ambassadeur.
À cette décision s’ajoute un climat de méfiance alimenté par des divergences sur des dossiers sensibles. La coopération migratoire, suspendue unilatéralement par l’Algérie, en est un exemple: Alger refusait depuis plusieurs mois de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires à l’expulsion d’Algériens en situation irrégulière en France. Un blocage vivement critiqué à Paris, notamment après l’attentat de Mulhouse en février 2025, commis par un ressortissant algérien sous obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Retailleau, l’étincelle de trop
Dans cette atmosphère déjà tendue, les déclarations de Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, ont contribué à envenimer la situation. En janvier 2025, au lendemain de l’attentat de Mulhouse, il accuse publiquement Alger de ne pas “jouer le jeu” dans la coopération sécuritaire, et va jusqu’à qualifier l’Algérie de “pays complice par passivité”. Ces propos provoquent un tollé à Alger où ils sont perçus comme une stigmatisation injuste et une tentative de faire porter la responsabilité de l’insécurité française à un partenaire étranger. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dénonce alors une “campagne hostile” menée par certains cercles politiques français.
Ces tensions sont également alimentées par d'autres figures politiques françaises, dont Gérard Larcher, qui appelle à une “remise à plat totale” de la relation franco-algérienne, jugée “déséquilibrée”. Quant au ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, il adopte une posture plus mesurée, affirmant en mars que Paris veut “résoudre les tensions avec exigence, mais sans provocation”.
L’affaire Boualem Sansal
Parmi les éléments les plus inflammables de cette crise diplomatique, figure l’affaire Boualem Sansal, qui a durablement envenimé les relations entre Paris et Alger. Le 27 mars dernier, l’écrivain franco-algérien a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 500.000 dinars (environ 3.470 euros) par le tribunal de Dar el-Beïda, près d’Alger. Arrêté en novembre 2024, il était depuis en détention provisoire.
L'Algérie lui reproche d’avoir tenu des propos polémiques dans la revue française d’extrême droite Frontières, évoquant notamment l’appartenance de l’ouest algérien au Maroc – un sujet hautement sensible.
Accusé d’atteinte à la sûreté de l’État, à l’intégrité du territoire, à la stabilité des institutions, et même d’intelligence avec des parties étrangères, l’écrivain est également soupçonné d’avoir transmis des “informations sensibles à caractère sécuritaire et économique”. Si la perpétuité a été écartée, la sévérité de la condamnation a été perçue en France comme un geste hostile, exacerbant une crise déjà bien installée.
Relance prudente mais déterminée
C’est dans ce contexte qu’intervient la visite de Jean-Noël Barrot à Alger le 6 avril 2025. Objectif: rétablir un canal de dialogue direct et relancer les coopérations suspendues. Le ministre français des Affaires étrangères s’est entretenu pendant plus de deux heures avec son homologue algérien Ahmed Attaf, avant d’être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune.
À l’issue de cette visite, les deux pays annoncent la “reprise complète de la coopération bilatérale dans tous les domaines”, notamment migratoire, économique et sécuritaire. M. Barrot insiste sur une relance “sans délai” et “sans conditions”. Le président Tebboune déclare pour sa part que “le rideau est levé” sur cette crise.
Derrière cette volonté de réconciliation se cachent des intérêts communs. La France, confrontée à des défis migratoires et sécuritaires croissants, a besoin de la coopération algérienne. L’Algérie, de son côté, cherche à restaurer une forme de respect dans la relation bilatérale, notamment sur le plan de la mémoire et de la souveraineté régionale.
Mais pour parvenir à un apaisement durable, Paris et Alger devront dépasser les gestes symboliques et engager un travail de fond sur les causes profondes des tensions: la question mémorielle, la politique migratoire, la stabilité régionale et le respect mutuel.

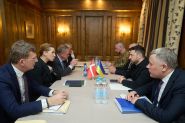


Commentaires