
Un geste fou déchire le voile feutré d’un musée : une femme crève les yeux d’un Rembrandt. Qui est Sandrine Maurin? Artiste radicale, folle magnifique, ou symptôme d’une société électrifiée jusqu’à l’âme? Damien Ribeiro orchestre une polyphonie magistrale autour de cet acte inaugural, déployant une enquête aux confins de l’art, de la révolte et de la sensibilité bafouée. Un roman saisissant, d’une acuité rare, qui sonde les fractures intimes et collectives avec une puissance narrative inoubliable.
Le roman de Damien Ribeiro, Électrosensibles, s’ouvre non pas sur un cri, mais sur un rassemblement silencieux, presque aviaire. Des femmes, bientôt surnommées "les corneilles" par une presse avide de pittoresque macabre, se tiennent telles des sentinelles devant la maison familiale d’une certaine Sandrine Maurin née Stievenard. Leur présence muette, à l’arrière-plan d’une journaliste venue filmer le théâtre pavillonnaire d’un drame, instaure d’emblée une atmosphère d’expectative lourde, de guet lancinant. Ces "corneilles" sont les premières à sentir, peut-être, la nature sismique du geste posé quelques heures plus tôt au Louvre-Lens: Sandrine a crevé les yeux d’un Rembrandt. Pas n’importe lequel: le Portrait d’Hendrickje Stoffels au béret de velours, figure douce et résignée, incarnation d’une certaine féminité sage que l’histoire de l’art et la société patriarcale aiment à consacrer. Le geste est brutal, iconoclaste, immédiatement taxé de folie. Il constitue le point nodal d’où irradie une exploration polyphonique des fissures intimes et collectives de notre contemporanéité.
Les oiseaux noirs et l'acte impensable
Le récit nous immerge dans cette onde de choc par le biais de regards multiples, diffractés. D’abord celui des "corneilles" - Garance, Lucie, Léa, Rose -, petit groupe sororal où militance larvée et intuition quasi mystique se côtoient. Elles perçoivent dans l’acte de Sandrine, avant tout le monde, "ce qui se jouait là", une rupture signifiante, un refus radical qui dépasse la simple lecture pathologique. Leur veille obstinée, sous le regard hostile du voisinage incarné par la commère Madame Sikora, transforme le trottoir provincial en espace de résistance symbolique.
Face à cette appréhension quasi instinctive, Damien Ribeiro place Pascal, figure tragi-comique de l’expert malgré lui. Professeur d’arts plastiques désabusé, cultivant une neurasthénie élégante et une propension aux échappées belles dans les méandres de l’histoire de l’art - ce qui lui vaut le sobriquet cruel de "Tavieilli" -, il est mandaté par le juge Valois, aussi empressé que démuni, pour trancher: le geste de Sandrine relève-t-il de la performance artistique ou de l’aliénation mentale? Cette mission, absurde et dérisoire, lance Pascal dans une quête qui s’avérera moins une enquête objective qu’une dérive existentielle, sur les traces d’une femme insaisissable et d’une compagne, Lucie, dont l’absence creuse en lui un vide obsédant. L’ironie mordante avec laquelle Damien Ribeiro dépeint les atermoiements de Pascal, ses digressions sur Cranach ou Egon Schiele face à l’urgence supposée de sa mission, souligne d’emblée le décalage abyssal entre les cadres institutionnels et la violence sourde des réalités qu’ils prétendent juguler. Sa note d’expert, préparée avec une application presque scolaire, listant les propriétaires successifs de l’œuvre et les poncifs sur Rembrandt - "L’un des plus grands peintres de l’histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque" -, devient un parangon de l’inanité face à la charge symbolique du geste de Sandrine.
Territoires intimes et plaies sociales
Le périple de Pascal, de Lens à Port-l’Annonciade puis Amélie-les-Eaux, n’est pas seulement géographique; il dessine une cartographie de l’aliénation contemporaine. Chaque lieu visité fonctionne comme un écosystème révélateur d’une pathologie sociale. Lens, bassin minier reconverti en vitrine culturelle muséifiée, superpose les strates d’une histoire ouvrière effacée au profit d’un simulacre post-industriel. Port-l’Annonciade, "terre d’artistes" autoproclamée, juxtapose la rudesse portuaire et industrielle - ces "dizaines [d’usines] qui ceinturaient la ville: dépôts de pétrole, de gaz, cimenterie" - à une prétention bohème frelatée, incarnée par un marché artisanal et des postes de surveillance de plage à l’esthétique californienne dérisoire. Amélie-les-Eaux, enfin, station thermale hors du temps, devient le lieu d’une "macédoine en boîte", symbole d’une vie aseptisée, d’une quête de salut par la norme et l’oubli de soi, où les curistes chassent l’éternité entre deux bains bouillonnants. Ces territoires, décrits avec une précision sensorielle aiguë - l’odeur âcre de la forêt, la lumière crue du Sud, le vrombissement des usines -, sont moins des décors que des personnages à part entière, miroirs des enfermements et des tentatives de fuite des protagonistes.
Au cœur de ces paysages intérieurs et extérieurs se meuvent des figures féminines saisissantes de vérité et de complexité. Sandrine Maurin née Stievenard, personnage central et pourtant fantomatique, agit comme un trou noir narratif, aspirant les interprétations sans jamais livrer sa propre clé. Son geste initial est une déflagration, mais sa trajectoire ultérieure - la fuite en forêt avec Tonio, la construction obsessionnelle de nids, l’évocation de son électrosensibilité - brouille les pistes. Est-elle une artiste radicale, une folle échappée, une militante écologiste intuitive, une mère dénaturée fuyant le carcan familial symbolisé par le pantacourt grotesque de son mari ? Damien Ribeiro refuse de trancher, laissant Sandrine incarner la résistance par l’opacité même. Autour d’elle gravitent les "corneilles", dont la solidarité instinctive se nuance de divergences tactiques. Garance, intransigeante, voit dans l’acte de Sandrine le début des hostilités: "Sandrine a eu le courage insensé de s’attaquer à l’éternité. Elle a fissuré le temps. Quatre siècles qu’ils se branlent sur Rembrandt". Lucie, la professeure, cherche les mots justes, la médiation culturelle. Léa, la skateuse, incarne une forme de fluidité rebelle mais ancrée dans le présent. Rose, la caissière mère de famille, représente le lien ténu entre la marge et la norme. Ces femmes, par leurs interactions, leurs doutes, leurs actions (le collage nocturne du message "Tu n’es pas seule"), esquissent les contours d’une lutte collective embryonnaire, tâtonnante, mais profondément ancrée dans une nécessité de redéfinir les termes du visible et du dicible.
L’art comme champ de bataille
Électrosensibles engage une réflexion acérée sur le statut de l’art dans nos sociétés. Le Rembrandt profané n’est pas une cible anodine; il représente l’icône intouchable, le totem d’une culture occidentale sûre de ses hiérarchies, de son "sommeil éternel" que Sandrine vient perturber. La question posée à Pascal – art ou folie ? – est un leurre institutionnel. Le roman suggère que le geste de Sandrine, quelles que soient ses motivations profondes, acquiert une portée politique et artistique précisément parce qu’il défie cette sacralisation, parce qu’il inscrit la violence du corps et du vécu féminin dans l’espace aseptisé du musée. La récupération de Sandrine par Kendrick Lamar (figure fictionnalisée mais emblématique d’une certaine conscience politique) ajoute une strate d’ironie: l’art contemporain, même lorsqu’il se veut subversif, participe à une forme de spectacularisation qui peut neutraliser la radicalité du geste initial. Garance, lucide et amère, dénonce cette appropriation: "Un type très connu, qui débarque et qui décide qu’on peut valider son œuvre […] Sois contente, un homme t’adoube". Le roman questionne ainsi la capacité de l’art à être autre chose qu’un commentaire ou une marchandise, à redevenir un acte, une effraction dans le réel.
Le murmure des invisibles
Électrosensibles vibre à l’unisson des tensions qui traversent notre époque. Le récit tisse avec finesse les fils des débats sur les violences systémiques faites aux femmes, l’invisibilisation des maladies environnementales comme l’électrosensibilité, la critique des normes sociales (le couple, la maternité hétéronormée que Sandrine rejette avec violence), la charge mentale implicite, la précarisation existentielle. La condition des femmes y est disséquée sans fard, depuis les micro-agressions quotidiennes jusqu’aux formes plus insidieuses d’aliénation. La solitude et la désintégration des liens sociaux dans un monde hyperconnecté mais paradoxalement atomisé (l’obsession de Pascal pour son téléphone et le fil ténu qui le relie à Lucie, les appels désespérés à la radio qu’écoute Francis Spinetti) sont rendues palpables. Le roman de Damien Ribeiro n’est pas un pensum sociologique, mais une œuvre littéraire qui incarne ces problématiques dans le destin de ses personnages, dans leurs gestes infimes ou leurs éclats brutaux.
Le fantôme de Wanda, le film de Barbara Loden, hante explicitement le roman, cité par les "corneilles" et implicitement par la trajectoire de Sandrine, cette femme à la dérive, "un peu bizarre, mais pas folle", dont la fuite est moins une quête de liberté qu’un arrachement douloureux à un monde qui ne lui offre aucune place désirable. Pascal, lui-même, avec sa fascination pour les figures féminines de l’art et sa propre incapacité à "retenir" Lucie, dialogue avec une longue tradition de regards masculins sur le féminin, entre fascination et incompréhension. Le roman s’inscrit ainsi dans une généalogie de récits de l’errance féminine, mais il la déplace en la politisant, en reliant l’intime à une critique plus vaste des systèmes de domination. L’intertextualité (Huysmans, Rembrandt, Picasso, Le Corbusier, la musique de Bon Iver ou de Siouxsie) n’est pas un jeu gratuit d’érudition; elle ancre le récit dans une mémoire culturelle pour mieux en questionner les héritages et les impensés.
Plus qu’un roman à thèse, Électrosensibles se déploie comme un manifeste polyphonique et fragmenté. Il ne propose pas de solution unique, mais juxtapose des voix, des colères, des stratégies de survie. La radicalité intransigeante de Garance, le pragmatisme militant de Léa, la quête spirituelle ou pathologique de Sandrine, le désarroi intellectuel de Pascal, le mutisme poignant de Tonio composent une mosaïque de résistances possibles face à un ordre social qui broie les singularités. Le message "Tu n’ es pas seule" n’est pas seulement un tag sur un mur; il est l’écho de cette tentative de recréer du lien, de la sororité, face à l’atomisation. Le roman nous oblige à écouter ces murmures, ces voix souvent discordantes, qui s’élèvent depuis les marges, les zones blanches de la carte sociale et sensible.
La résistance par la fissure
Électrosensibles oppose à la saturation médiatique et à la stérilité des discours experts la force brute de l’énigme et la puissance de l’empathie narrative. Dans un monde avide de clarté, de diagnostics et de solutions rapides, Damien Ribeiro choisit l’opacité, la complexité, le questionnement sans réponse définitive. La résistance qu’il propose est celle de la fissure, de l’incomplétude assumée. Le roman ne guérit pas, il expose la plaie. Il ne juge pas, il accompagne le vacillement. En refusant de choisir entre la folie et le manifeste, entre l’art et le cri, il redonne au geste de Sandrine - et par extension, à toutes les formes de refus qui échappent aux catégorisations faciles - sa charge subversive intacte.
Que réveille cette lecture? Un sentiment d’urgence, une colère sourde face aux innombrables façons dont le réel policé étouffe les voix singulières. Une reconnaissance, aussi, de cette part d’ombre, d’irréductible étrangeté, qui nous habite tous et que nous passons nos vies à masquer ou à nier. Électrosensibles nous rappelle que c’est souvent dans ces zones d’inconfort, dans l’écoute des échos fracturés du monde, que réside la possibilité d’une vérité plus essentielle, d’une résistance intime qui, peut-être, est le dernier rempart contre l’anesthésie généralisée. Le roman nous laisse non pas apaisés, mais vibrants, traversés par ces ondes invisibles qui sont, peut-être, le langage secret du vivant.
Damien Ribeiro, Électrosensibles, Éditions du Rouergue, 05/03/2025, 240 pages, 21,50€
https://marenostrum.pm/une-odyssee-dans-les-zones-blanches-de-letre/



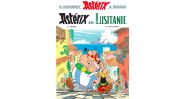
Commentaires